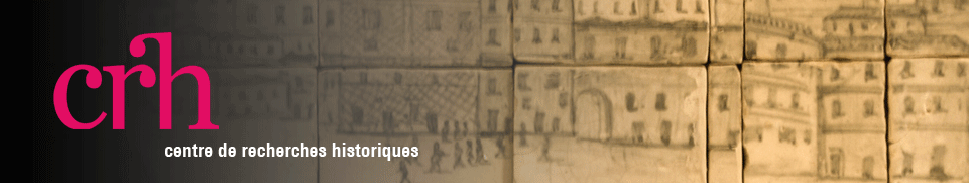Actus RSS
Actualités
Pouvoirs de l’imagination. Approches historiques
 Journée(s) d'étude - Vendredi 3 mai 2024 - 09:15Séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (chargée de recherche au CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir (chargé de recherche au CNRS). Le séminaire est financé par le CRH, Sphere, l’UPEC et l’ANR ANTHRAME.La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et pratique alternative et méconnue : depuis les XIIe-XIIIe siècles jusqu’au début du XIXe siècle, des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands pouvoirs. Comme les années précédentes, ce séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de confrontation des sources sur la longue durée. Il prendra la forme de trois journées complètes.Pour recevoir les informations relatives à ces journée, en particulier le lien de connexion, il est recommandé de s’inscrire. Programme9h15-10h45 : Lada Murareva (EPHE)L’imagination dans le contexte des maladies mentales (selon les œuvres des XIIIe-XIVe siècles)11h-12h30 : Fosca Mariani Zini (Université de Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance)L'imagination dans le néoplatonisme humaniste, ou comment une faculté médiatrice devient la premièrePause déjeuner13h45-15h15 : Roberto Poma (Université de Créteil)Imagination dynamique et dynamiques de l’imagination chez Gaston Bachelard
Journée(s) d'étude - Vendredi 3 mai 2024 - 09:15Séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (chargée de recherche au CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir (chargé de recherche au CNRS). Le séminaire est financé par le CRH, Sphere, l’UPEC et l’ANR ANTHRAME.La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et pratique alternative et méconnue : depuis les XIIe-XIIIe siècles jusqu’au début du XIXe siècle, des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands pouvoirs. Comme les années précédentes, ce séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de confrontation des sources sur la longue durée. Il prendra la forme de trois journées complètes.Pour recevoir les informations relatives à ces journée, en particulier le lien de connexion, il est recommandé de s’inscrire. Programme9h15-10h45 : Lada Murareva (EPHE)L’imagination dans le contexte des maladies mentales (selon les œuvres des XIIIe-XIVe siècles)11h-12h30 : Fosca Mariani Zini (Université de Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance)L'imagination dans le néoplatonisme humaniste, ou comment une faculté médiatrice devient la premièrePause déjeuner13h45-15h15 : Roberto Poma (Université de Créteil)Imagination dynamique et dynamiques de l’imagination chez Gaston Bachelard
Les Lundis du CRH autour de l'ouvrage de Julia Cagé et Thomas Piketty : Une histoire du conflit politique
 Débat - Lundi 6 mai 2024 - 14:00Qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué de 1789 à 2022 ? En s’appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques des 36 000 communes de France couvrant plus de deux siècles, Une histoire du conflit politique (Seuil, 2023), de Julia Cagé et Thomas Piketty, propose une histoire du vote et des inégalités à partir du laboratoire français.Au-delà de son intérêt historique, ce livre apporte un regard neuf sur les crises du présent et leur possible dénouement. La tripartition de la vie politique issue des élections de 2022, avec d’une part un bloc central regroupant un électorat socialement beaucoup plus favorisé que la moyenne – et réunissant d’après les sources ici rassemblées le vote le plus bourgeois de toute l’histoire de France –, et de l’autre des classes populaires urbaines et rurales divisées entre les deux autres blocs, ne peut être correctement analysée qu’en prenant le recul historique nécessaire. En particulier, ce n’est qu’en remontant à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à une époque où l’on observait des formes similaires de tripartition avant que la bipolarisation ne l’emporte pendant la majeure partie du siècle dernier, que l’on peut comprendre les tensions à l’oeuvre aujourd’hui. La tripartition a toujours été instable alors que c’est la bipartition qui a permis le progrès économique et social. Comparer de façon minutieuse les différentes configurations permet de mieux envisager plusieurs trajectoires d’évolutions possibles pour les décennies à venir.Une entreprise d’une ambition unique qui ouvre des perspectives nouvelles pour sortir de la crise actuelle. Toutes les données collectées au niveau des quelques 36 000 communes de France sont disponibles en ligne en accès libre sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, qui comprend des centaines de cartes, graphiques et tableaux interactifs auxquels le lecteur pourra se reporter afin d’approfondir ses propres analyses et hypothèses.Le débat sera animé par Dinah Ribard, en présence des auteurs, avec la participation de Pascal Cristofoli (EHESS-CNRS, CRH), Laurent Joly (CNRS-EHESS, CRH) et Anne-France Taiclet (Université Paris 1-CNRS-EHESS, CESSP).S'inscrireEn savoir plus sur l'ouvrage
Débat - Lundi 6 mai 2024 - 14:00Qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué de 1789 à 2022 ? En s’appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques des 36 000 communes de France couvrant plus de deux siècles, Une histoire du conflit politique (Seuil, 2023), de Julia Cagé et Thomas Piketty, propose une histoire du vote et des inégalités à partir du laboratoire français.Au-delà de son intérêt historique, ce livre apporte un regard neuf sur les crises du présent et leur possible dénouement. La tripartition de la vie politique issue des élections de 2022, avec d’une part un bloc central regroupant un électorat socialement beaucoup plus favorisé que la moyenne – et réunissant d’après les sources ici rassemblées le vote le plus bourgeois de toute l’histoire de France –, et de l’autre des classes populaires urbaines et rurales divisées entre les deux autres blocs, ne peut être correctement analysée qu’en prenant le recul historique nécessaire. En particulier, ce n’est qu’en remontant à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à une époque où l’on observait des formes similaires de tripartition avant que la bipolarisation ne l’emporte pendant la majeure partie du siècle dernier, que l’on peut comprendre les tensions à l’oeuvre aujourd’hui. La tripartition a toujours été instable alors que c’est la bipartition qui a permis le progrès économique et social. Comparer de façon minutieuse les différentes configurations permet de mieux envisager plusieurs trajectoires d’évolutions possibles pour les décennies à venir.Une entreprise d’une ambition unique qui ouvre des perspectives nouvelles pour sortir de la crise actuelle. Toutes les données collectées au niveau des quelques 36 000 communes de France sont disponibles en ligne en accès libre sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, qui comprend des centaines de cartes, graphiques et tableaux interactifs auxquels le lecteur pourra se reporter afin d’approfondir ses propres analyses et hypothèses.Le débat sera animé par Dinah Ribard, en présence des auteurs, avec la participation de Pascal Cristofoli (EHESS-CNRS, CRH), Laurent Joly (CNRS-EHESS, CRH) et Anne-France Taiclet (Université Paris 1-CNRS-EHESS, CESSP).S'inscrireEn savoir plus sur l'ouvrage
Ressources et empires. La construction sociale des écosystèmes impériaux
 Appel à communication - Samedi 15 juin 2024 - 18:00ArgumentaireLa conquête de l’Amérique par les Espagnols est habituellement considérée comme le début de bouleversements démographiques, économiques et écologiques à l’échelle planétaire. Qu’il s’agisse de l’hécatombe démographique provoquée par la combinaison létale entre exploitation de la main d’œuvre et choc microbien, ou de la destruction des écosystèmes préhispaniques sur l’autel de l’extractivisme colonial, un fil conducteur relie les analyses les plus classiques : l’articulation entre conquête, extractivisme et destruction des milieux et des humains. Ainsi, « l’impérialisme écologique » cher à Alfred Crosby, tout comme l’approche plus localisée d’Elinor Melville, décrivaient la destruction des plantes indigènes par le bétail et la fin d’une agriculture intensive irriguée au profit d’un pastoralisme extensif, sur des terres désertifiées, et d’un paysage par conséquent entièrement « centré sur l’animal ». En allant plus loin, Simon Lewis et Mark Maslin ont pu avancer que la disparition des milliers d'hectares autrefois cultivés par les populations amérindiennes et rendus à la forêt expliqueraient le « petit âge glaciaire » dès la fin du xvie siècle. Ces approches et les débats qu’elles ont suscités, laissent de nombreuses questions en suspens. Que doit-on comprendre au juste par « impérialisme écologique » ? La notion de catastrophe écologique (« a plague of sheep ») est-elle pertinente quel que soit le contexte et le moment ? Les notions de résilience, d’appropriation, de négociation, ont-elles une place dans la compréhension des transformations écologiques provoquées par les invasions européennes ? Jusqu’à quel point une notion comme celle d’« extractivisme » est-elle appropriée pour des réalités pré-industrielles ? La prédation des sociétés humaines sur leur environnement a-t-elle commencé avec l’industrialisation ? Est-elle consubstantielle au colonialisme ? Existe-t-elle dans les sociétés préhispaniques ? Est-elle uniquement liée à l’extractivisme ?Ce colloque, organisé par Jeronimo Bermudez (GEI), Antoine Duranton (GEI), Antoine Roullet (GEI), Jean-Paul Zuñiga (GEI) avec la participation du GRHEN, se propose de remettre sur l’établi les grands modèles nés dans les 1980 grâce à la mise en travail de trois domaines et de trois historiographies qui ont peu dialogué jusqu’à présent : l’histoire de l’empire espagnol, l’histoire environnementale et l’histoire sociale. L’objectif est de réintroduire les méthodes de l’histoire sociale afin de reconsidérer les grands récits et les grands concepts, les approches macroscopiques, à l’aune d’analyses fondées sur les acteurs et sur la variété des contextes spécifiques. Ce dialogue peut s’avérer d’autant plus fertile que l’histoire environnementale concernent pour l’essentiel les XIXe et XXe siècles. L’Amérique préindustrielle y apparaît ainsi largement comme une terra incognita. Ce colloque, nous l’espérons, sera l’occasion de décloisonner les questionnaires et de réinterroger l’histoire impériale à la lumière des grandes problématiques traitées postérieurement par l’histoire environnementale. Quatre thématiques d’analyses sont privilégiées et sont susceptibles d’accueillir des communications qui auront à cœur de replacer les approches impériale et environnementale à l’échelle des cycles de vie des acteurs.Ressources naturelles et ressources démographiques. Cette thématique se propose d’explorer les liens entre histoire environnementale et histoire du travail, en interrogeant les rythmes et les modalités de la transformation du milieu à partir des dynamiques de coercition et de discipline notamment pour ce qui est de la disponibilité et de la captation de la main d’œuvre dans un contexte démographique catastrophique et dans une situation coloniale, tout comme pour ce qui est de la régulation politique, urbaine et corporative de l’exploitation des ressources.Ordre social et transformations écologiques. Cette thématique explore les rapports sociaux qui sous-tendent toute transformation écologique, de l’exercice du pouvoir aux luttes pour le pouvoir en matière d’usages des ressources que ce soit pour réévaluer, par exemple, l’ « agency » des communautés indiennes face aux autorités coloniales ou de relire les archives produites par les politiques de questionnaire de la monarchie espagnole (visitas, relaciones, etc...) dans son organisation territoriale sur le continent américain (congregaciones, créations de villes nouvelles, déplacements de centres urbains...). Pénurie, mise sur le marché et gestion des ressources. Cette thématique interroge le préjugé circulatoire qui pèse sur les ressources impériales et entend examiner la tension entre économie de subsistance et économie marchande, les formes d’exploitation et de marchandisation (commodification) des ressources, et la fabrication de leur valeur locale et commerciale, à la lumière des contraintes biologiques ou matérielles (pénuries locales, difficulté du transport et de conservation), de leur viabilité économique dans une situation où les marchés sont segmentés et spatialisés différemment selon chaque ressource et où les possibilités et les incapacités d’exploitation d’une ressource diffèrent beaucoup d’un cas à l’autre.Constructions locales du paysage. Comment les rapports sociaux entre les acteurs, décelables uniquement à l’échelle locale, permettent-ils de comprendre la configuration spécifique des ressources, des campagnes et des pratiques de production ? Peut-on expliquer uniquement par le relief les formes du paysage morcelées des exploitations des hautes vallées d’Antioquia en Nouvelle Grenade, celles des grandes estancias du Chili central ou du no man’s land rioplatense ? Quelles sont les rapports qui s’établissent entre milieux, savoir-faire, démographie et évolution des paysages ? Calendrier et modalités de soumissionNous recevons toute proposition concernant XVI-XVIIIe siècles sur tous les espaces américains et toutes les dominations coloniales, présentée en 5 000 caractères maximum, avant le 15 juin 2024, à l’une des adresses suivantes : jeronimo.bermudez@ehess.fr, antoine.duranton@ehess.fr, antoine.roullet@ehess.fr ou jean-paul.zuniga@ehess.fr
Appel à communication - Samedi 15 juin 2024 - 18:00ArgumentaireLa conquête de l’Amérique par les Espagnols est habituellement considérée comme le début de bouleversements démographiques, économiques et écologiques à l’échelle planétaire. Qu’il s’agisse de l’hécatombe démographique provoquée par la combinaison létale entre exploitation de la main d’œuvre et choc microbien, ou de la destruction des écosystèmes préhispaniques sur l’autel de l’extractivisme colonial, un fil conducteur relie les analyses les plus classiques : l’articulation entre conquête, extractivisme et destruction des milieux et des humains. Ainsi, « l’impérialisme écologique » cher à Alfred Crosby, tout comme l’approche plus localisée d’Elinor Melville, décrivaient la destruction des plantes indigènes par le bétail et la fin d’une agriculture intensive irriguée au profit d’un pastoralisme extensif, sur des terres désertifiées, et d’un paysage par conséquent entièrement « centré sur l’animal ». En allant plus loin, Simon Lewis et Mark Maslin ont pu avancer que la disparition des milliers d'hectares autrefois cultivés par les populations amérindiennes et rendus à la forêt expliqueraient le « petit âge glaciaire » dès la fin du xvie siècle. Ces approches et les débats qu’elles ont suscités, laissent de nombreuses questions en suspens. Que doit-on comprendre au juste par « impérialisme écologique » ? La notion de catastrophe écologique (« a plague of sheep ») est-elle pertinente quel que soit le contexte et le moment ? Les notions de résilience, d’appropriation, de négociation, ont-elles une place dans la compréhension des transformations écologiques provoquées par les invasions européennes ? Jusqu’à quel point une notion comme celle d’« extractivisme » est-elle appropriée pour des réalités pré-industrielles ? La prédation des sociétés humaines sur leur environnement a-t-elle commencé avec l’industrialisation ? Est-elle consubstantielle au colonialisme ? Existe-t-elle dans les sociétés préhispaniques ? Est-elle uniquement liée à l’extractivisme ?Ce colloque, organisé par Jeronimo Bermudez (GEI), Antoine Duranton (GEI), Antoine Roullet (GEI), Jean-Paul Zuñiga (GEI) avec la participation du GRHEN, se propose de remettre sur l’établi les grands modèles nés dans les 1980 grâce à la mise en travail de trois domaines et de trois historiographies qui ont peu dialogué jusqu’à présent : l’histoire de l’empire espagnol, l’histoire environnementale et l’histoire sociale. L’objectif est de réintroduire les méthodes de l’histoire sociale afin de reconsidérer les grands récits et les grands concepts, les approches macroscopiques, à l’aune d’analyses fondées sur les acteurs et sur la variété des contextes spécifiques. Ce dialogue peut s’avérer d’autant plus fertile que l’histoire environnementale concernent pour l’essentiel les XIXe et XXe siècles. L’Amérique préindustrielle y apparaît ainsi largement comme une terra incognita. Ce colloque, nous l’espérons, sera l’occasion de décloisonner les questionnaires et de réinterroger l’histoire impériale à la lumière des grandes problématiques traitées postérieurement par l’histoire environnementale. Quatre thématiques d’analyses sont privilégiées et sont susceptibles d’accueillir des communications qui auront à cœur de replacer les approches impériale et environnementale à l’échelle des cycles de vie des acteurs.Ressources naturelles et ressources démographiques. Cette thématique se propose d’explorer les liens entre histoire environnementale et histoire du travail, en interrogeant les rythmes et les modalités de la transformation du milieu à partir des dynamiques de coercition et de discipline notamment pour ce qui est de la disponibilité et de la captation de la main d’œuvre dans un contexte démographique catastrophique et dans une situation coloniale, tout comme pour ce qui est de la régulation politique, urbaine et corporative de l’exploitation des ressources.Ordre social et transformations écologiques. Cette thématique explore les rapports sociaux qui sous-tendent toute transformation écologique, de l’exercice du pouvoir aux luttes pour le pouvoir en matière d’usages des ressources que ce soit pour réévaluer, par exemple, l’ « agency » des communautés indiennes face aux autorités coloniales ou de relire les archives produites par les politiques de questionnaire de la monarchie espagnole (visitas, relaciones, etc...) dans son organisation territoriale sur le continent américain (congregaciones, créations de villes nouvelles, déplacements de centres urbains...). Pénurie, mise sur le marché et gestion des ressources. Cette thématique interroge le préjugé circulatoire qui pèse sur les ressources impériales et entend examiner la tension entre économie de subsistance et économie marchande, les formes d’exploitation et de marchandisation (commodification) des ressources, et la fabrication de leur valeur locale et commerciale, à la lumière des contraintes biologiques ou matérielles (pénuries locales, difficulté du transport et de conservation), de leur viabilité économique dans une situation où les marchés sont segmentés et spatialisés différemment selon chaque ressource et où les possibilités et les incapacités d’exploitation d’une ressource diffèrent beaucoup d’un cas à l’autre.Constructions locales du paysage. Comment les rapports sociaux entre les acteurs, décelables uniquement à l’échelle locale, permettent-ils de comprendre la configuration spécifique des ressources, des campagnes et des pratiques de production ? Peut-on expliquer uniquement par le relief les formes du paysage morcelées des exploitations des hautes vallées d’Antioquia en Nouvelle Grenade, celles des grandes estancias du Chili central ou du no man’s land rioplatense ? Quelles sont les rapports qui s’établissent entre milieux, savoir-faire, démographie et évolution des paysages ? Calendrier et modalités de soumissionNous recevons toute proposition concernant XVI-XVIIIe siècles sur tous les espaces américains et toutes les dominations coloniales, présentée en 5 000 caractères maximum, avant le 15 juin 2024, à l’une des adresses suivantes : jeronimo.bermudez@ehess.fr, antoine.duranton@ehess.fr, antoine.roullet@ehess.fr ou jean-paul.zuniga@ehess.fr
Au regard de l'histoire, dynamiques de l'exil académique
 Journée(s) d'étude - Jeudi 4 avril 2024 - 10:00L’appartenance des sociétés russes et chinoises à des espaces impériaux façonnés par l’expérience du communisme fait peser une durable suspicion d’altérité sociale et de méfiance politique à leur égard. Cette suspicion est fortement renforcée par les crises du présent (pandémie, guerre, tensions géopolitiques internationales…). Pour penser ces enjeux immédiats et les saisir dans leur historicité, l’objectif de ce séminaire, organisé autour de trois journées d’études thématiques, consiste à rendre justice aux dynamiques sociales et politiques qui permettent de rendre intelligibles ces sociétés. En Chine et en Russie, comment se reconfigurent les pratiques sociales et politiques dans des espaces confrontés à leur manière aux défis du XXe et du XXIe siècle et comment, dans le même temps, se manifeste la présence du passé ? Comment les trajectoires et les réflexions qui accompagnent les choix et les engagements des acteurs permettent tant l’inventivité sociale que la reconfiguration de la contrainte et de l’oppression politique ?En 2023-2024, les journées du séminaire animé par Isabelle Thireau (CNRS-EHESS, CCJ-CECMC), Françoise Daucé (CNRS-EHESS, CERCEC) et Sebastian Veg (EHESS-CNRS, CRH, associé au CECMC), Enquêter en Chine et en Russie. À la recherche d’appuis communs pour la réflexion, seront organisées autour du thème commun du décentrement, compris dans une acception sociologique au plus proche des acteurs, de leurs pratiques et de leurs réflexivités. Nous nous appuierons tant sur des matériaux historiographiques que sur des enquêtes de terrain, tant sur des observations en cours que sur des récits rétrospectifs. En proposant un dialogue conjoint aux chercheurs, jeunes et confirmés, qui travaillent sur les sociétés chinoise et russe, il ne s’agit pas de développer des comparaisons terme à terme mais plutôt de partager des problèmes, des références et des réflexions sur les dispositifs et pratiques d’enquête pour contribuer ensemble à une meilleure compréhension des sociétés russe et chinoise et, au-delà, à l’avancement des sciences sociales autour des questions de l’expérience de la rupture historique, des déplacements choisis et subis, de l’action en public, de l’oppression politique ou de l’économie des transformations sociales (en fonction des thèmes choisis pour les journées…).Les personnes qui souhaitent assister à distance doivent s’inscrire pour recevoir un lien de connexion : S’inscrire à l’UE 542 Programme10h00 - 10h30 : Accueil et introduction10h30-12h30 : Muséalisation et patrimonialisation, à domicile et en exilModération : Sebastian Veg (EHESS-CNRS, CRH)Jean-Philippe Béjà (CERI), Les musées du 4 juin (Tiananmen), de Hong-Kong à New-YorkDmitry Oparine (Université de Bordeaux, PAUSE), Restauration, muséification et patrimonialisation derrière la façade autoritaire en Russie12h30 - 14h00 : Déjeuner / buffet à la tisanerie14h00 – 16h00 : La recherche au défi des déplacements obligésModération : Françoise Daucé (CNRS-EHESS, CERCEC)Jessica Wong (EHESS, Doctorante PAUSE), Parcours de réflexion sur l'exil des militants-étudiants de HongkongBoris Melnichenko (CNRS-EHESS, CERCEC, Doctorant), Vulnérabilité et exil. Le cas de Svobodnij Universitet (L'Université libre)16h00 - 16h30 : Pause- café16h15-18h15 : Les circulations sous contrainte des collectifs académiquesModération : Isabelle Thireau (EHESS-CNRS, CCJ)Laure Zhang (Université de Genève), Quelques réflexions sur l’académie entre décentrement, déplacement, exil et circulationsYulia Sineokaya (IPHI-HIPHIMO), Le monde académique de la Russie en exil à la recherche d'une nouvelle identité
Journée(s) d'étude - Jeudi 4 avril 2024 - 10:00L’appartenance des sociétés russes et chinoises à des espaces impériaux façonnés par l’expérience du communisme fait peser une durable suspicion d’altérité sociale et de méfiance politique à leur égard. Cette suspicion est fortement renforcée par les crises du présent (pandémie, guerre, tensions géopolitiques internationales…). Pour penser ces enjeux immédiats et les saisir dans leur historicité, l’objectif de ce séminaire, organisé autour de trois journées d’études thématiques, consiste à rendre justice aux dynamiques sociales et politiques qui permettent de rendre intelligibles ces sociétés. En Chine et en Russie, comment se reconfigurent les pratiques sociales et politiques dans des espaces confrontés à leur manière aux défis du XXe et du XXIe siècle et comment, dans le même temps, se manifeste la présence du passé ? Comment les trajectoires et les réflexions qui accompagnent les choix et les engagements des acteurs permettent tant l’inventivité sociale que la reconfiguration de la contrainte et de l’oppression politique ?En 2023-2024, les journées du séminaire animé par Isabelle Thireau (CNRS-EHESS, CCJ-CECMC), Françoise Daucé (CNRS-EHESS, CERCEC) et Sebastian Veg (EHESS-CNRS, CRH, associé au CECMC), Enquêter en Chine et en Russie. À la recherche d’appuis communs pour la réflexion, seront organisées autour du thème commun du décentrement, compris dans une acception sociologique au plus proche des acteurs, de leurs pratiques et de leurs réflexivités. Nous nous appuierons tant sur des matériaux historiographiques que sur des enquêtes de terrain, tant sur des observations en cours que sur des récits rétrospectifs. En proposant un dialogue conjoint aux chercheurs, jeunes et confirmés, qui travaillent sur les sociétés chinoise et russe, il ne s’agit pas de développer des comparaisons terme à terme mais plutôt de partager des problèmes, des références et des réflexions sur les dispositifs et pratiques d’enquête pour contribuer ensemble à une meilleure compréhension des sociétés russe et chinoise et, au-delà, à l’avancement des sciences sociales autour des questions de l’expérience de la rupture historique, des déplacements choisis et subis, de l’action en public, de l’oppression politique ou de l’économie des transformations sociales (en fonction des thèmes choisis pour les journées…).Les personnes qui souhaitent assister à distance doivent s’inscrire pour recevoir un lien de connexion : S’inscrire à l’UE 542 Programme10h00 - 10h30 : Accueil et introduction10h30-12h30 : Muséalisation et patrimonialisation, à domicile et en exilModération : Sebastian Veg (EHESS-CNRS, CRH)Jean-Philippe Béjà (CERI), Les musées du 4 juin (Tiananmen), de Hong-Kong à New-YorkDmitry Oparine (Université de Bordeaux, PAUSE), Restauration, muséification et patrimonialisation derrière la façade autoritaire en Russie12h30 - 14h00 : Déjeuner / buffet à la tisanerie14h00 – 16h00 : La recherche au défi des déplacements obligésModération : Françoise Daucé (CNRS-EHESS, CERCEC)Jessica Wong (EHESS, Doctorante PAUSE), Parcours de réflexion sur l'exil des militants-étudiants de HongkongBoris Melnichenko (CNRS-EHESS, CERCEC, Doctorant), Vulnérabilité et exil. Le cas de Svobodnij Universitet (L'Université libre)16h00 - 16h30 : Pause- café16h15-18h15 : Les circulations sous contrainte des collectifs académiquesModération : Isabelle Thireau (EHESS-CNRS, CCJ)Laure Zhang (Université de Genève), Quelques réflexions sur l’académie entre décentrement, déplacement, exil et circulationsYulia Sineokaya (IPHI-HIPHIMO), Le monde académique de la Russie en exil à la recherche d'une nouvelle identité
"L’orang-outan des Lumières" : Silvia Sebastiani revient sur la découverte des grands singes et les controverses autour des frontières de l’humain
Communiqué -Silvia Sebastiani, historienne de l’EHESS, interviendra le mercredi 24 avril 2024 à 18h au Muséum national d’Histoire naturelle, lors d’une conférence intitulée : « L’orang-outan des Lumières : à la recherche du chaînon manquant ». Cette conférence inédite s’inscrit dans le cycle de conférences Marc Bloch que propose l’EHESS pour faire dialoguer sciences sociales et sciences expérimentales. L’EHESS développe hors les murs un dialogue interdisciplinaire, dont le public pourra bénéficier lors de cette conférence gratuite, ouverte à toutes et tous, sur inscription.S'inscrire à la conférence Penser et vivre l’interdisciplinarité au Muséum national d’Histoire naturelleFaisant suite à la présentation de Svante Pääbo, prix Nobel de médecine, lors de la conférence annuelle Marc Bloch de l’EHESS en novembre 2023, l’historienne Silvia Sebastiani interviendra le 24 avril 2024 au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris). Dans une conférence intitulée « L’orang-outan des Lumières : à la recherche du chaînon manquant », elle montrera comment l’étude des grands singes aux 17e et 18e siècles a contribué à une meilleure connaissance de l’Homme et à l’élaboration des sciences sociales et des sciences du vivant.Cet événement s’inscrit dans un cycle de conférences Marc Bloch inédit et dédié en 2024 à l’interdisciplinarité, qui perpétue, à l’image des conférences Marc Bloch annuelles que l’EHESS organise depuis 1979, « un dialogue avec d’autres disciplines pour faire en sorte que la science ne soit pas limitée à un champ spécifique, les sciences sociales ou les sciences expérimentales, mais soit à l'inverse ouverte à un dialogue fécond pour comprendre les sociétés humaines », selon Romain Huret, président de l’EHESS. Cette quatrième conférence succède à celles de l’historienne Claudine Cohen, de l’anthropologue Philippe Descola et de l’assyriologue Grégory Chambon.Elle marque aussi la poursuite d’une collaboration renforcée entre l’EHESS, établissement producteur de savoirs en sciences sociales, et le Muséum national d’Histoire naturelle.En organisant cet événement au Muséum national d’Histoire naturelle, l’EHESS poursuit son objectif de dialogue interdisciplinaire et d’ouverture sur la société et le territoire. L’orang-outan des Lumières, à la recherche du chaînon manquantSilvia Sebastiani s’intéresse dans cette conférence à l’« orang-outan », ou « homme des bois », qui fait son entrée dans l’Europe du 17e siècle par les premiers traités médicaux. En 1699, l’anatomiste anglais Edward Tyson soulève un problème central : la spécificité de l’Homme et de son statut face à des animaux si proches. En établissant des correspondances entre l’humain et l’orang-outan, il brouille les frontières entre les deux et provoque un trouble au cœur des controverses des Lumières. Trouver le « grand singe » devient le mot d’ordre de l’Europe du 18e siècle dans le but de mieux comprendre l’Homme.Cette enquête traverse toutes les disciplines en cours de constitution : médecine, histoire naturelle, droit, philosophie, histoire, etc. La quête de l’orang-outan, au-delà des théâtres anatomiques et des ménageries, conduit aussi sur les routes du commerce triangulaire qui fournit les métropoles en spécimens. L’exhibition publique du grand singe via les circuits marchands de l’esclavage manifeste le caractère désormais politique des controverses sur les frontières de l’humain et pose la question des différents degrés d’humanités. Silvia Sebastiani, historienne du monde moderneSilvia Sebastiani enseigne à l’EHESS. Historienne spécialiste des Lumières, elle travaille sur les questions de race et de genre et sur l’écriture de l’histoire, notamment en Écosse et dans l’Empire britannique. Elle est rattachée au Centre de recherches historiques (CRH – EHESS, CNRS) et au Groupe d’étude sur les historiographies modernes.Elle est l’autrice de The Scottish Enlightenment. Race, Gender, and the Limits of Progress (2008 en italien, 2013 en anglais), pour lequel elle a reçu le Prix Istvan Hont du meilleur livre d'histoire intellectuelle de l'année, et aussi la co-autrice, avec Jean-Frédéric Schaub, de Race et histoire dans les sociétés occidentales (15e-18e siècle) (2021). Son prochain livre portera sur les frontières de l’humanité au 18e siècle, au prisme des grands singes et de l’élaboration des sciences humaines et sociales. Informations pratiquesMercredi 24 avril 2024 à 18hMuséum national d'Histoire naturelleAmphithéâtre Verniquet57 rue Cuvier, 75005 ParisConférence suivie d'un cocktailGratuit - Inscription en ligne obligatoire :S'inscrire à la conférence Contact pressepresse@ehess.fr
Après le 7 octobre : repenser les études juives face au conflit en cours
 Journée(s) d'étude - Mercredi 3 avril 2024 - 10:00Suite aux attaques du 7 octobre 2023 en Israël et la guerre qui s'est éclatée ensuite à Gaza, quel est l’apport des études juives aujourd’hui à la compréhension de la situation non seulement en Israël/Palestine mais aussi en France ? Ce forum en ligne, organisé par Elad Lapidot (Unversité de Lille, CECILLE), Davide Mano (CRH-EJ) et Ron Naiweld (CRHEJ), entend stimuler une réflexion collective sur la situation actuelle des études juives en France, sur le sens et la pratique de nos travaux de recherche et d’enseignement en ce moment, face au conflit en cours.Pour recevoir le lien Zoom, merci de contacter : ej_crh@ehess.fr Programme10h00-10h15 : Introduction Elad Lapidot (Université de Lille, CECILLE)Davide Mano (CNRS-EHESS, CRH)Ron Naiweld (CNRS-EHESS, CRH)10h15-11h30 : 1re SéanceMadalina Vartejanu-Joubert (Inalco)David Lemler (Sorbonne Université)Denis Charbit (Open University of Israel/ SciencesPo, Menton)Pause-café11h45-13h00 : 2e SéanceYann Scioldo-Zürcher (CNRS-EHESS, CRH)Rina Cohen-Müller (Inalco)François Guesnet (UCL)Pause déjeuner14h30-16h15 : 3e SéanceEvelien Chayes (CNRS-IRHT)Yoann Morvan (CNRS-Mésopolhis)Sandrine Szwarc (Université Sorbonne Paris Nord - Institut Elie Wiesel)Scott Lerner (Franklin & Marshall College)Pause-café16h30-17h00 : Discussion générale
Journée(s) d'étude - Mercredi 3 avril 2024 - 10:00Suite aux attaques du 7 octobre 2023 en Israël et la guerre qui s'est éclatée ensuite à Gaza, quel est l’apport des études juives aujourd’hui à la compréhension de la situation non seulement en Israël/Palestine mais aussi en France ? Ce forum en ligne, organisé par Elad Lapidot (Unversité de Lille, CECILLE), Davide Mano (CRH-EJ) et Ron Naiweld (CRHEJ), entend stimuler une réflexion collective sur la situation actuelle des études juives en France, sur le sens et la pratique de nos travaux de recherche et d’enseignement en ce moment, face au conflit en cours.Pour recevoir le lien Zoom, merci de contacter : ej_crh@ehess.fr Programme10h00-10h15 : Introduction Elad Lapidot (Université de Lille, CECILLE)Davide Mano (CNRS-EHESS, CRH)Ron Naiweld (CNRS-EHESS, CRH)10h15-11h30 : 1re SéanceMadalina Vartejanu-Joubert (Inalco)David Lemler (Sorbonne Université)Denis Charbit (Open University of Israel/ SciencesPo, Menton)Pause-café11h45-13h00 : 2e SéanceYann Scioldo-Zürcher (CNRS-EHESS, CRH)Rina Cohen-Müller (Inalco)François Guesnet (UCL)Pause déjeuner14h30-16h15 : 3e SéanceEvelien Chayes (CNRS-IRHT)Yoann Morvan (CNRS-Mésopolhis)Sandrine Szwarc (Université Sorbonne Paris Nord - Institut Elie Wiesel)Scott Lerner (Franklin & Marshall College)Pause-café16h30-17h00 : Discussion générale
Pouvoirs de l’imagination
 Journée(s) d'étude - Vendredi 5 avril 2024 - 09:15Séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (chargée de recherche au CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir (chargé de recherche au CNRS). Le séminaire est financé par le CRH, Sphere, l’UPEC et l’ANR ANTHRAME.La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et pratique alternative et méconnue : depuis les XIIe-XIIIe siècles jusqu’au début du XIXe siècle, des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands pouvoirs. Comme les années précédentes, ce séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de confrontation des sources sur la longue durée. Il prendra la forme de trois journées complètes.Pour recevoir les informations relatives à ces journée, en particulier le lien de connexion, il est recommandé de s’inscrire :S'inscrire au séminaire Programme9h-9h15 : Introduction9h15-10h45 : Anne Sophie Jouanneau (chercheuse indépendante)« Pouvoir de l’affect chez l’Avicenne latin »11h-12h30 : Mali Alinejad Zanjani (ENS)« Les pouvoirs de l’imagination : enjeux éthiques et politiques de la théorie de l'âme d'Avicenne au XVIe siècle » Pause déjeuner 13h45-15h15 : Carmel Raz (Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt-sur-le-Main)« Ossianic Sounds: Berlioz on Memory »15h30-17h : Adrien Mangili (Université de Neuchâtel)« Force d'imagination et naturalisation du miraculeux »
Journée(s) d'étude - Vendredi 5 avril 2024 - 09:15Séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (chargée de recherche au CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir (chargé de recherche au CNRS). Le séminaire est financé par le CRH, Sphere, l’UPEC et l’ANR ANTHRAME.La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et pratique alternative et méconnue : depuis les XIIe-XIIIe siècles jusqu’au début du XIXe siècle, des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands pouvoirs. Comme les années précédentes, ce séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de confrontation des sources sur la longue durée. Il prendra la forme de trois journées complètes.Pour recevoir les informations relatives à ces journée, en particulier le lien de connexion, il est recommandé de s’inscrire :S'inscrire au séminaire Programme9h-9h15 : Introduction9h15-10h45 : Anne Sophie Jouanneau (chercheuse indépendante)« Pouvoir de l’affect chez l’Avicenne latin »11h-12h30 : Mali Alinejad Zanjani (ENS)« Les pouvoirs de l’imagination : enjeux éthiques et politiques de la théorie de l'âme d'Avicenne au XVIe siècle » Pause déjeuner 13h45-15h15 : Carmel Raz (Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt-sur-le-Main)« Ossianic Sounds: Berlioz on Memory »15h30-17h : Adrien Mangili (Université de Neuchâtel)« Force d'imagination et naturalisation du miraculeux »
 Actualités
Actualités
Forum de littérature médiévale comparée
 Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)
Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)
Lire l’État. Venise médiévale et ses territoires: représentations, cartographies, littératures
 Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)
Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)
Quantifier la Shoah. Classer, compter, modéliser / Quantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling
 Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)
Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)
CRH (UMR 8558)
EHESS
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 54 24 42
Direction du CRH :
Dernière modification :
27/04/2024