La reconnaissance de la République démocratique allemande (RDA) par la France, le 9 février 1973, dont on fête cette année le cinquantième anniversaire, initia les relations officielles entre les deux gouvernements. Les échanges entre la société française et la RDA avaient cependant déjà débuté dès les premiers jumelages franco-est-allemands et la création de l’Association des Échanges franco-allemands à la fin des années 1950. Ces échanges associatifs, municipaux, culturels, syndicaux, partisans et académiques continuèrent, en parallèle aux relations interministérielles, jusqu’à la disparition de la RDA en 1990.
De cette manière, à la suite des recherches de Dorothee Röseberg sur l’image de la France en RDA ainsi que des réflexions ouvertes par Nicolas Offenstadt sur les traces de la RDA en Allemagne de l’Est après 1990, il serait intéressant d’interroger les différents vestiges que cette relation disparue entre les deux pays a laissés en France. En effet, comme l’ont rappelé les travaux d’Ulrich Pfeil et de Christian Wenkel, la société française entretenait un rapport particulier à cette « autre Allemagne » qui servit de surface de projection à un certain nombre d’aspirations politiques et sociales. De ce fait, ces relations denses et multiples entre la France et la RDA ont aussi engendré des mémoires hétérogènes qu’il serait pertinent d’étudier comme objet historique en soi. Le programme du colloque est structuré par les quatre axes de recherche suivants :
- Les institutions est-allemandes en France et leur devenir après la disparition de la RDA
- La transformation et la poursuite des relations entre la France et l’Allemagne de l’Est après 1990
- La concurrence des mémoires de la RDA en France depuis la réunification
- Les acteurs et l’évolution de la recherche historique francophone sur la RDA
Comité d'organisation :
- Franck Schmidt (EHESS / Universität Heidelberg)
- Bettina Sund (EHESS / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Comité scientifique
- Simon Godard (Sciences Po Grenoble)
- Élisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle)
- Sandrine Kott (Université de Genève)
- Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther Halle-Wittenberg)
- Christian Wenkel (Université d’Artois)
Programme
9 novembre 2023
Soirée d’ouverture du colloque
Institut Goethe de Paris
17 avenue d’Iéna, 75016 Paris
18h-19h : Conférence : Expériences de Français en RDA – un double regard
- Élisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle)
- Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg / Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin)
19h-20h : Table ronde : Les relations entre la France et l’Allemagne de l’Est au passé et au présent
- Modération : Lucas Delattre (ancien correspondant du journal Le Monde en Allemagne)
- Avec Béatrice Angrand (attachée de coopération universitaire et directrice de l’Institut français de Rostock 1991-1996, secrétaire générale de l’OFAJ 2009-2019), Jean-Louis Leprêtre (ancien conseiller culturel à l’ambassade de France à Berlin-Est, en RDA), Stephan Steinlein (Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France) (sous réserve), et Christian Wenkel (Université d’Artois)
10 novembre 2023
Introduction (9h-9h15)
- Franck Schmidt (EHESS /Université de Heidelberg)
- Bettina Sund (EHESS /Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg)
Panel 1 : La gestion de l’héritage de la RDA en France (9h15-10h45)
Modération : Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg – Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin)
-
Mathilde Harel (Université de Lille)
Utopie et désenchantement. Les gauches françaises face à la Chute du mur de Berlin (1989-1991) -
Bénédicte Terrisse (Université de Nantes) - Ruth Lambertz-Pollan (Université de Nantes)
La RDA en France : Un reste livresque. Le cas de la bibliothèque universitaire de Nantes -
Bettina Sund (EHESS /Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg) Austauscherfahrungen : Lektor*innenitiativen der DDR und Frankreich (1973-1990)
Pause-café (10h45-11h)
Panel 2 : Transformations et réaménagement des relations franco-est-allemandes après 1990 (11h-12h30)
Modération : Christian Wenkel (Université d’Artois)
-
Mathilde Gancel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
L’ouverture du BILD et de la GÜZ à l’Allemagne de l’Est après 1990 -
William Richier (Université de Cergy-Pontoise)
L’évolution des jumelages entre la France et l’ex-RDA -
Franck Schmidt (EHESS /Université de Heidelberg)
L’association des EFA et l’Allemagne réunifiée : un rendez-vous manqué ?
Déjeuner (12h30-13h30)
Panel 3 : Réceptions et mémoires des œuvres est-allemandes en France (13h30-14h30)
Modération : Nicolas Offenstadt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
-
Adrien Bessire (Professeur agrégé d’allemand)
La réception de la littérature et du cinéma post-RDA en France après 1990 -
Coline Perron (Sciences Po Strasbourg/Université Paris Nanterre)
Transmission de la mémoire et réception du documentaire est-allemand “Solidarateau – Der rote Ring wird nicht gesprengt“ (1974)
Pause-café (14h30-14h45)
Discussion : La recherche historique francophone sur la RDA : acteurs et évolutions (14h45-16h)
Simon Godard (Sciences Po Grenoble) / Elisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle)
Conclusion (16h-16h15)
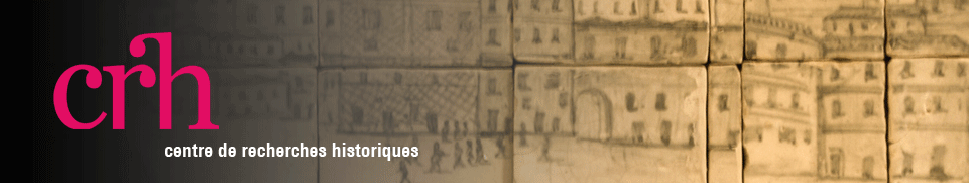

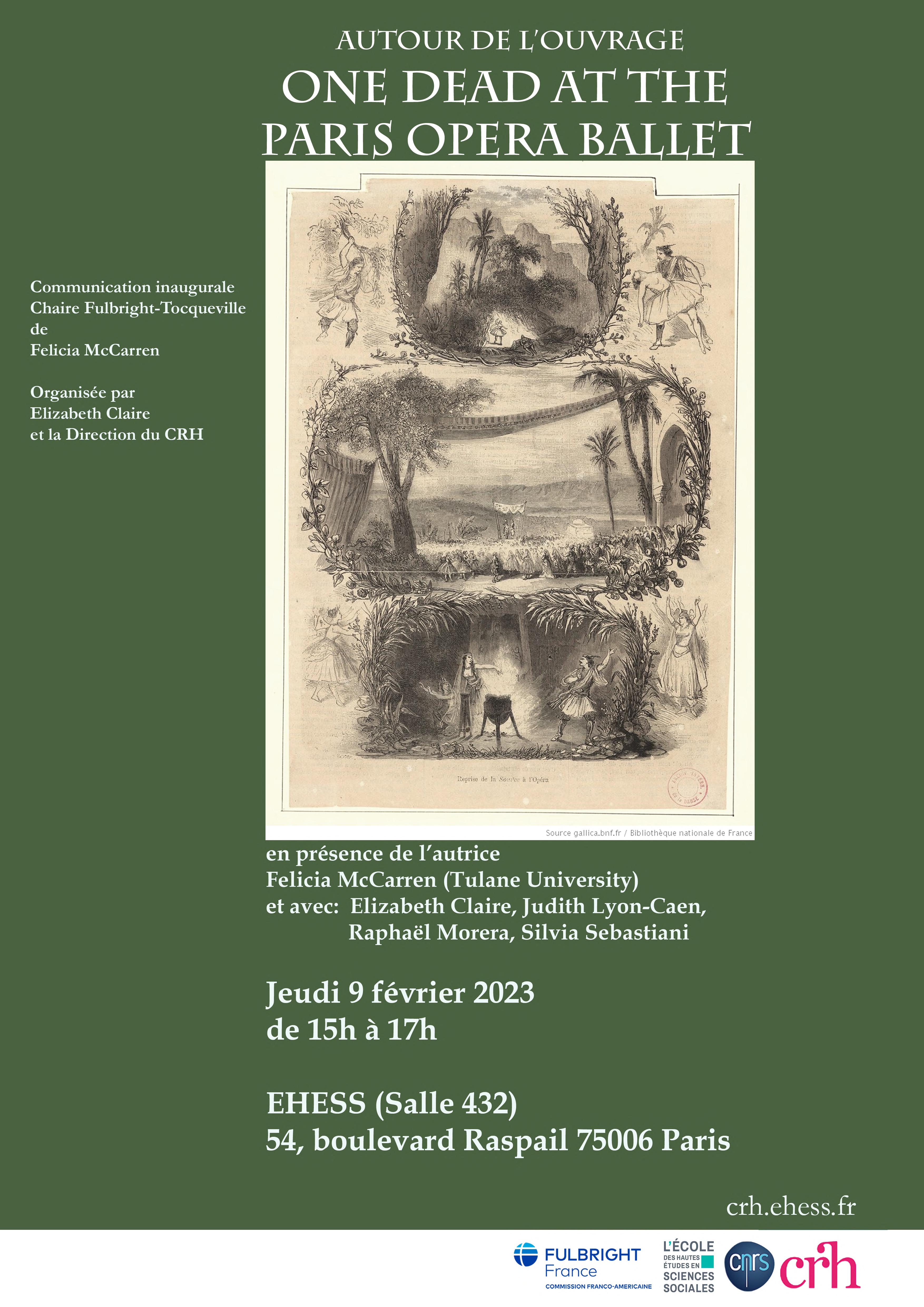
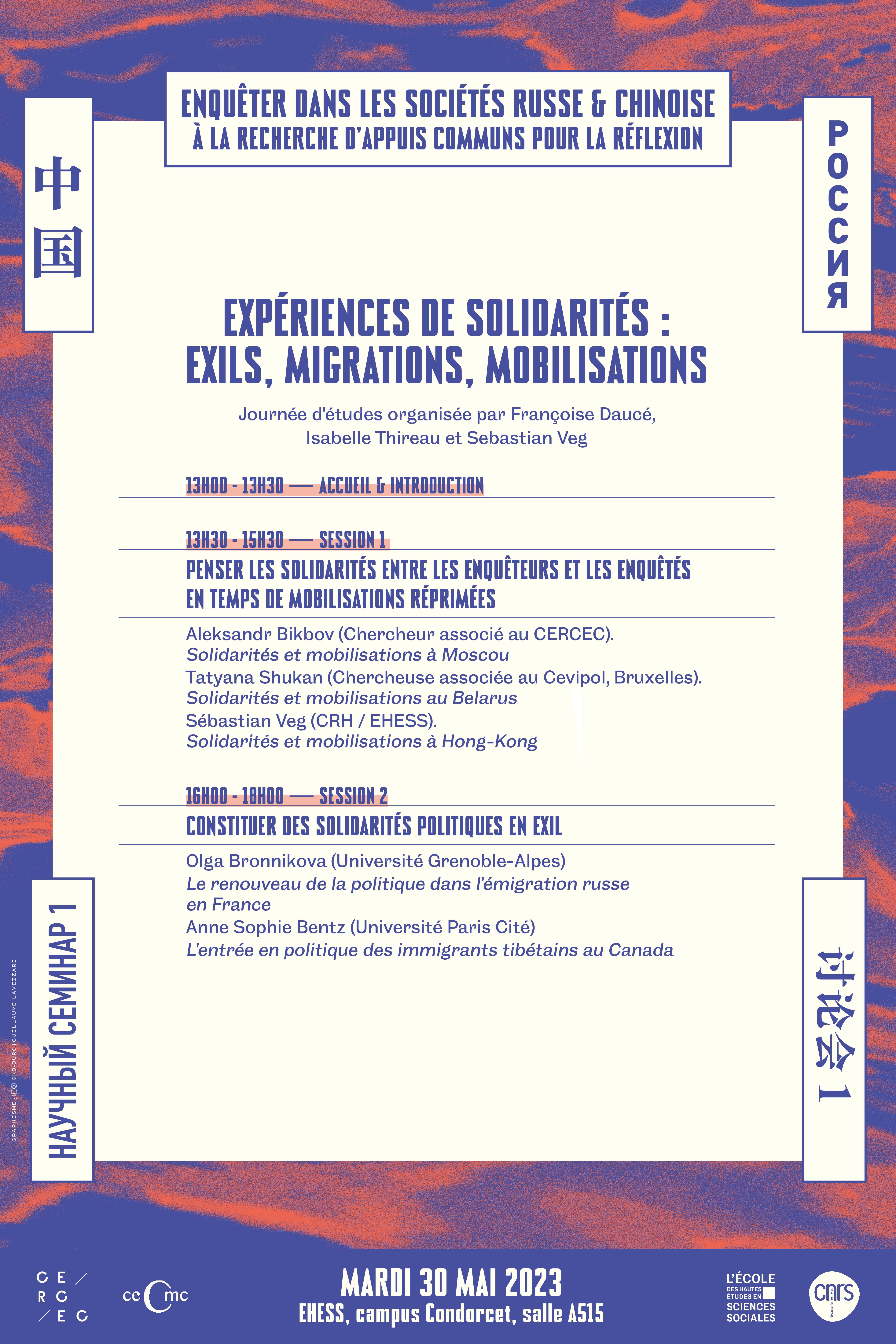
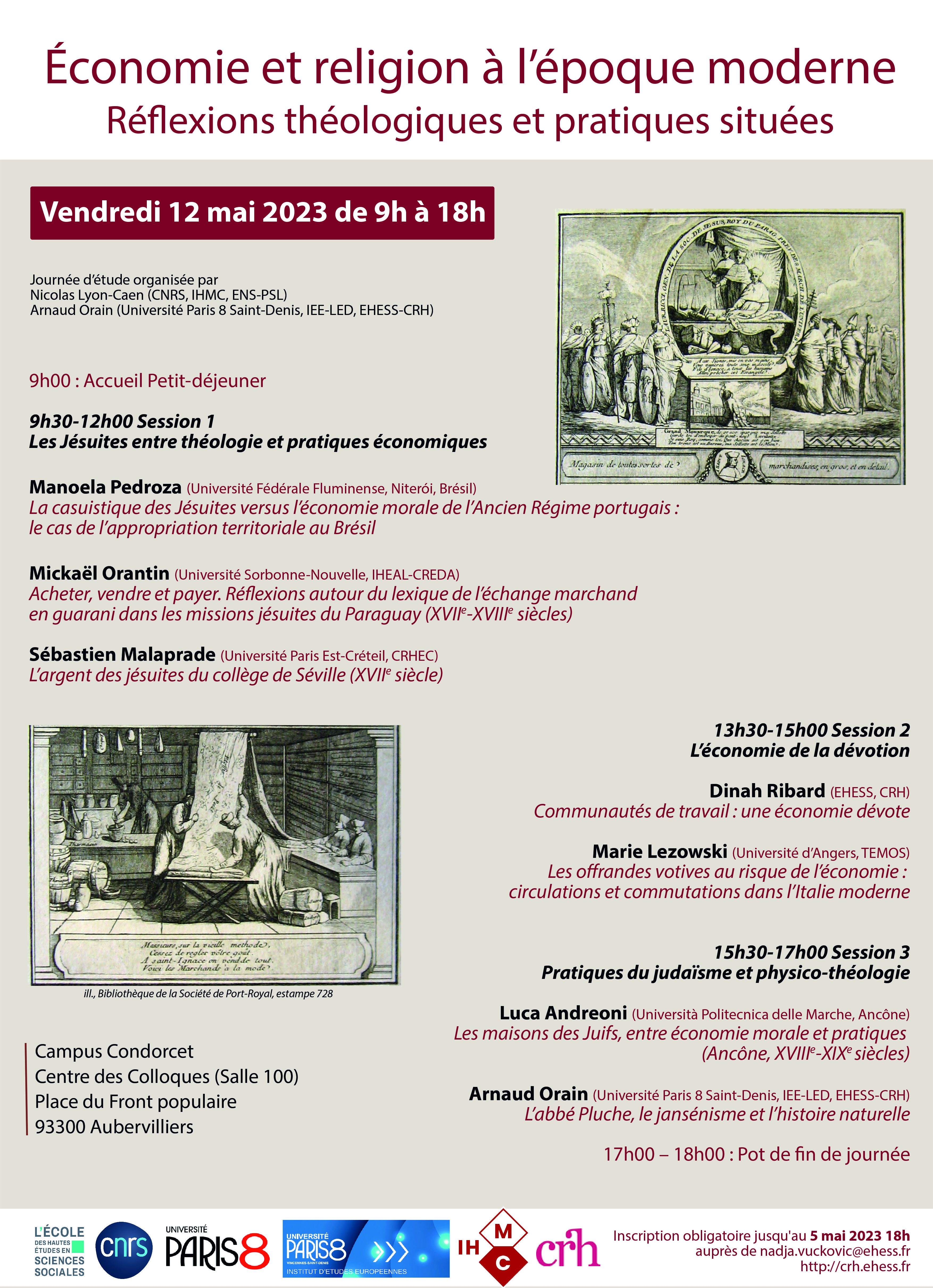


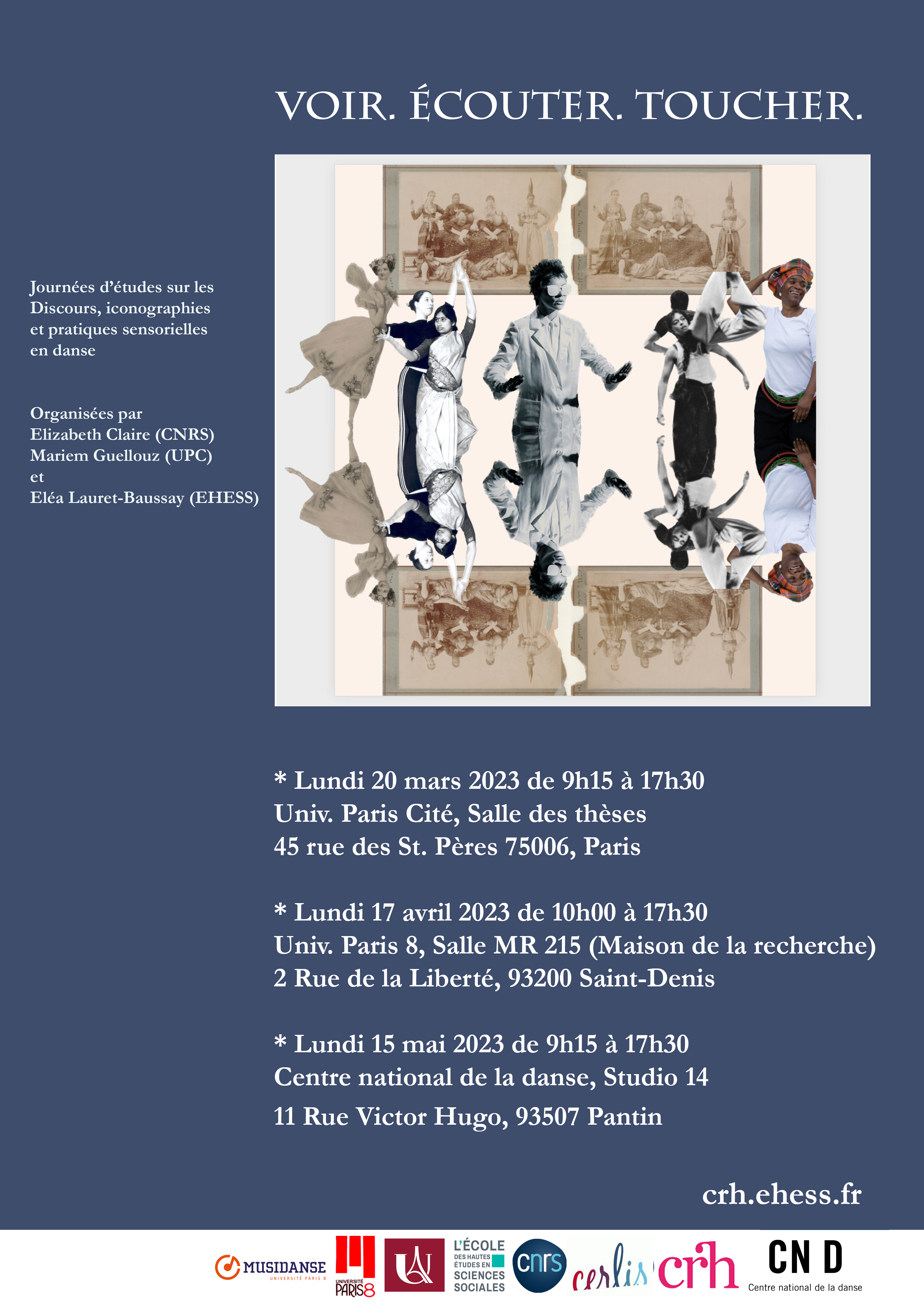

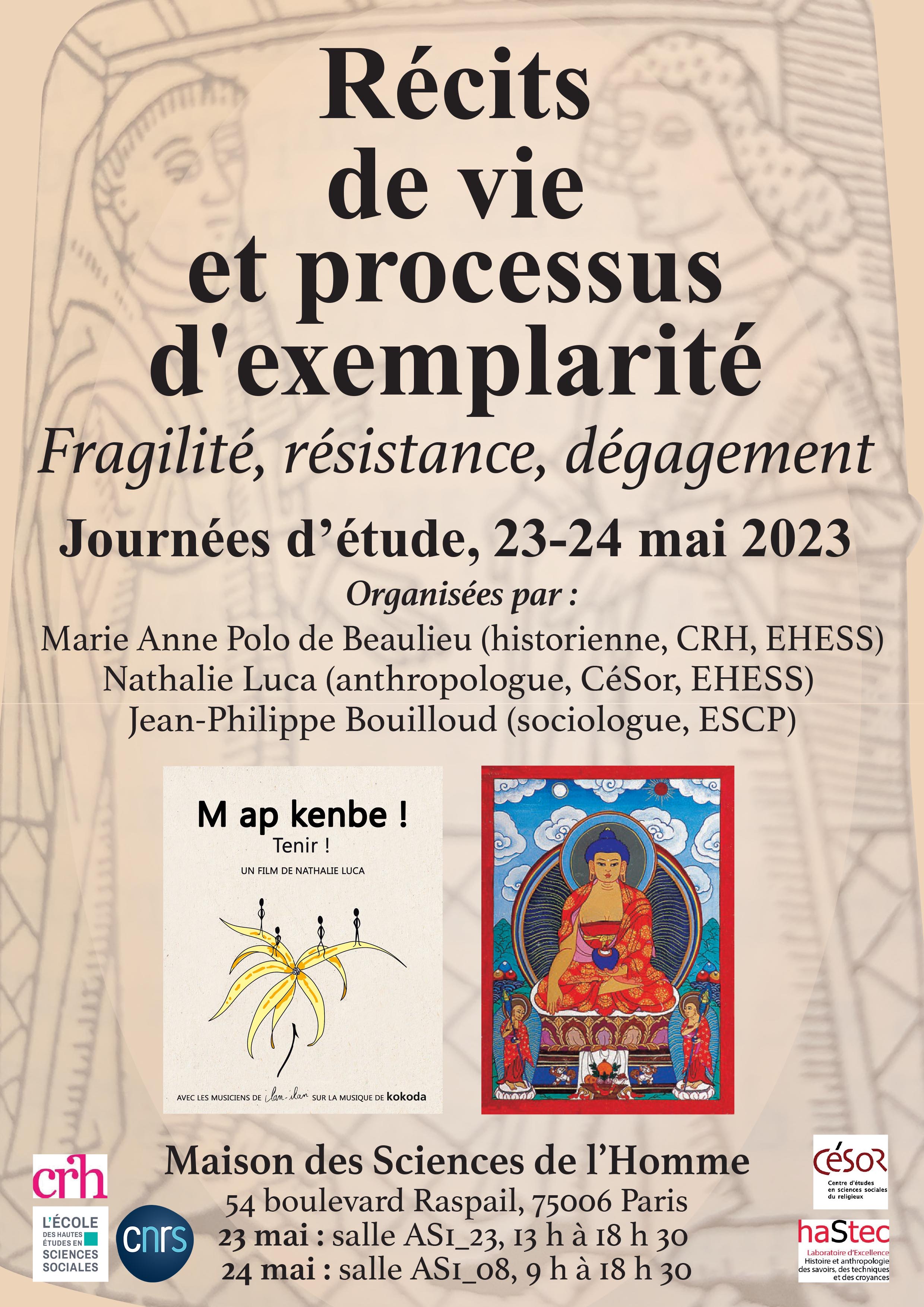
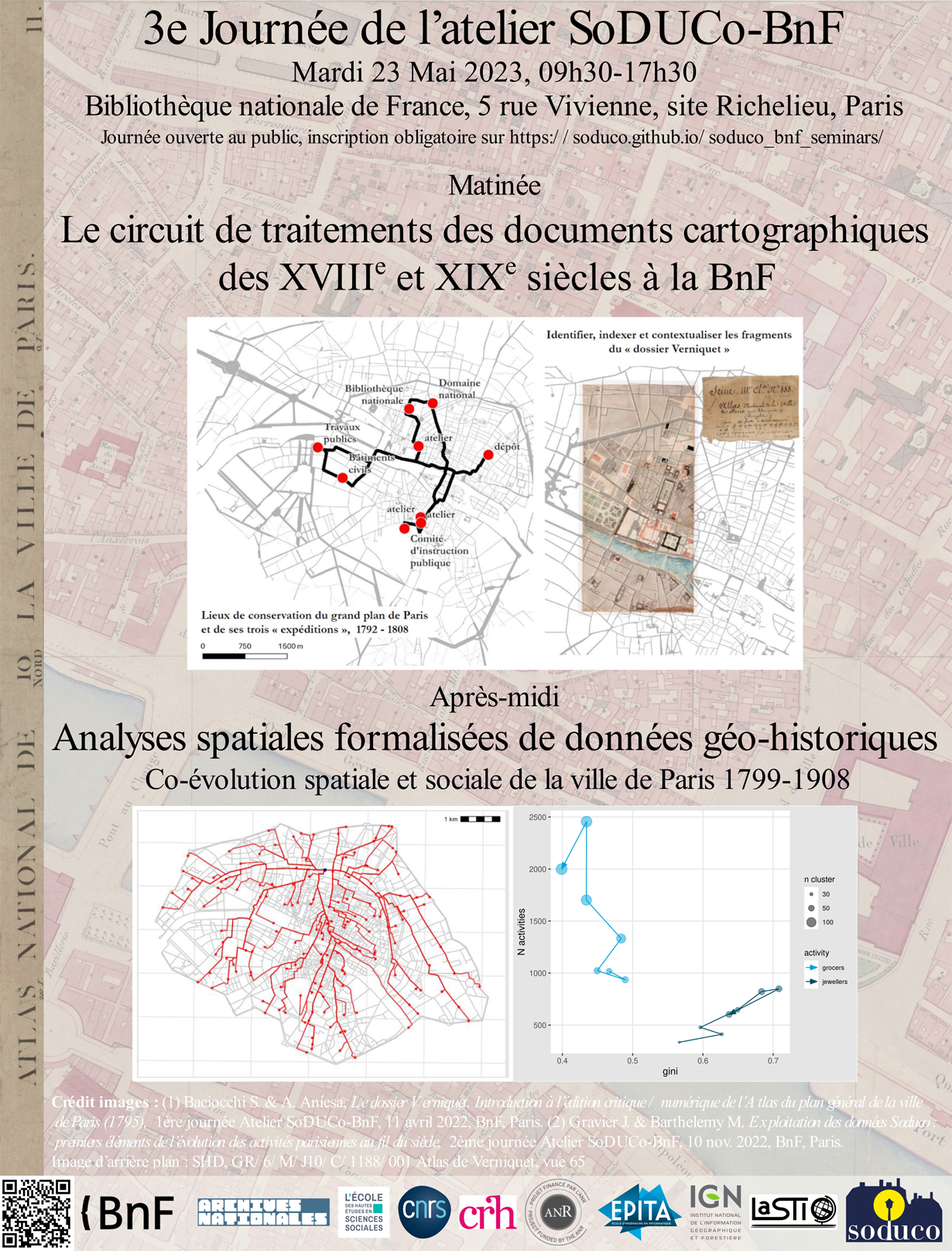
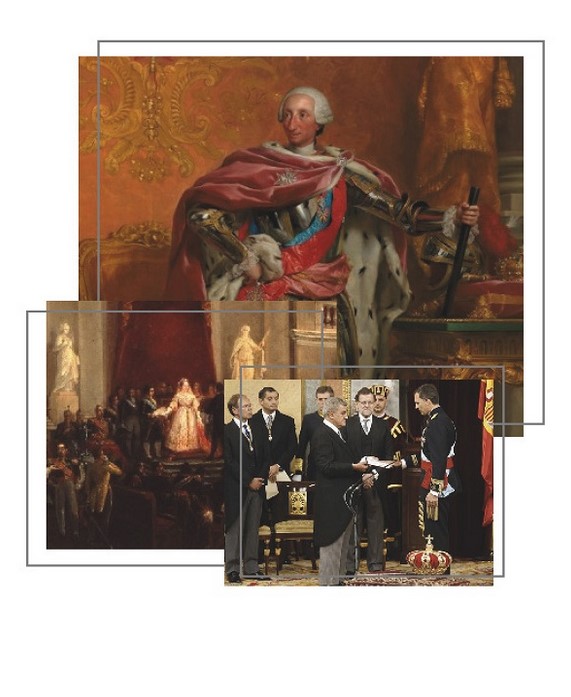

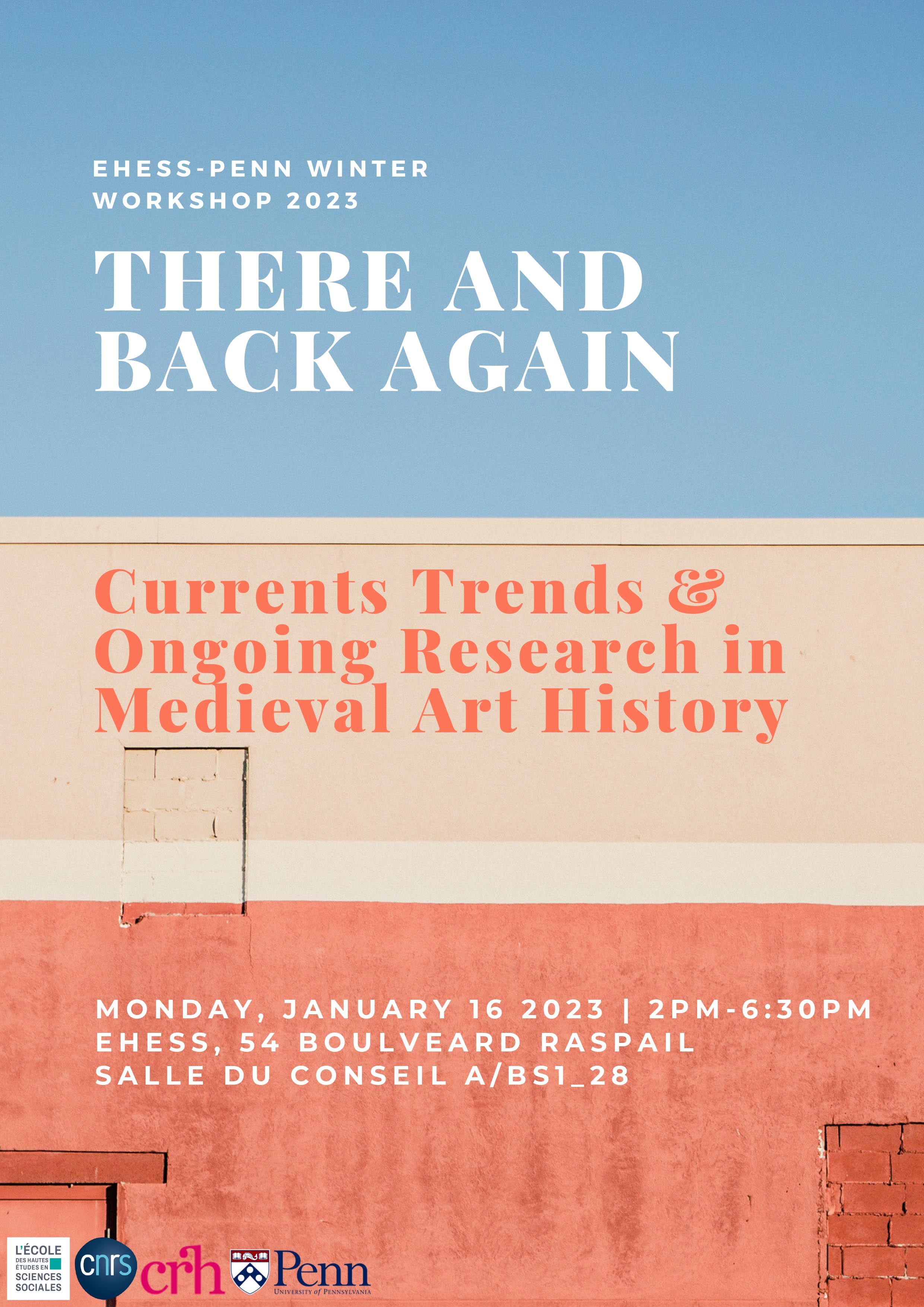
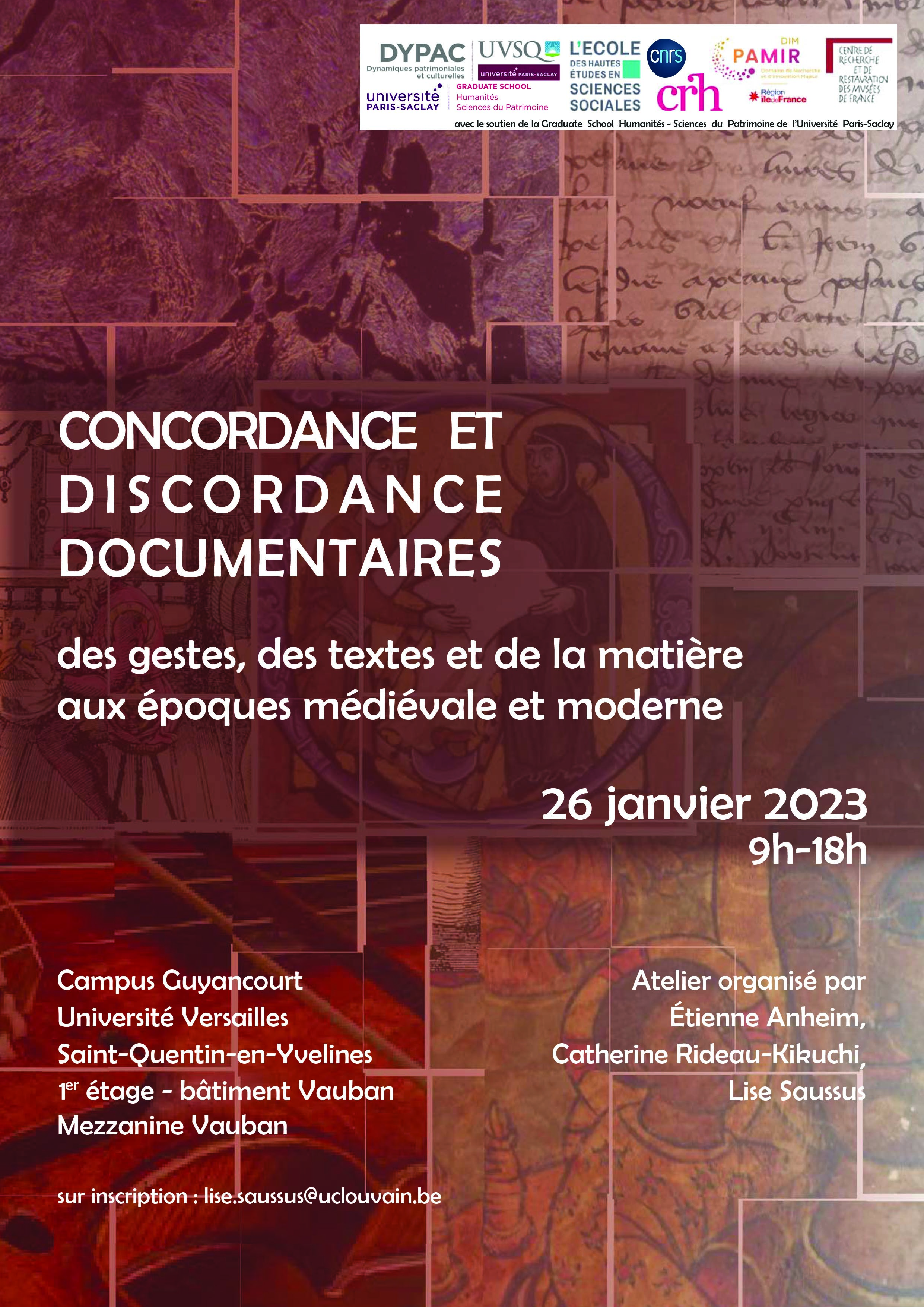
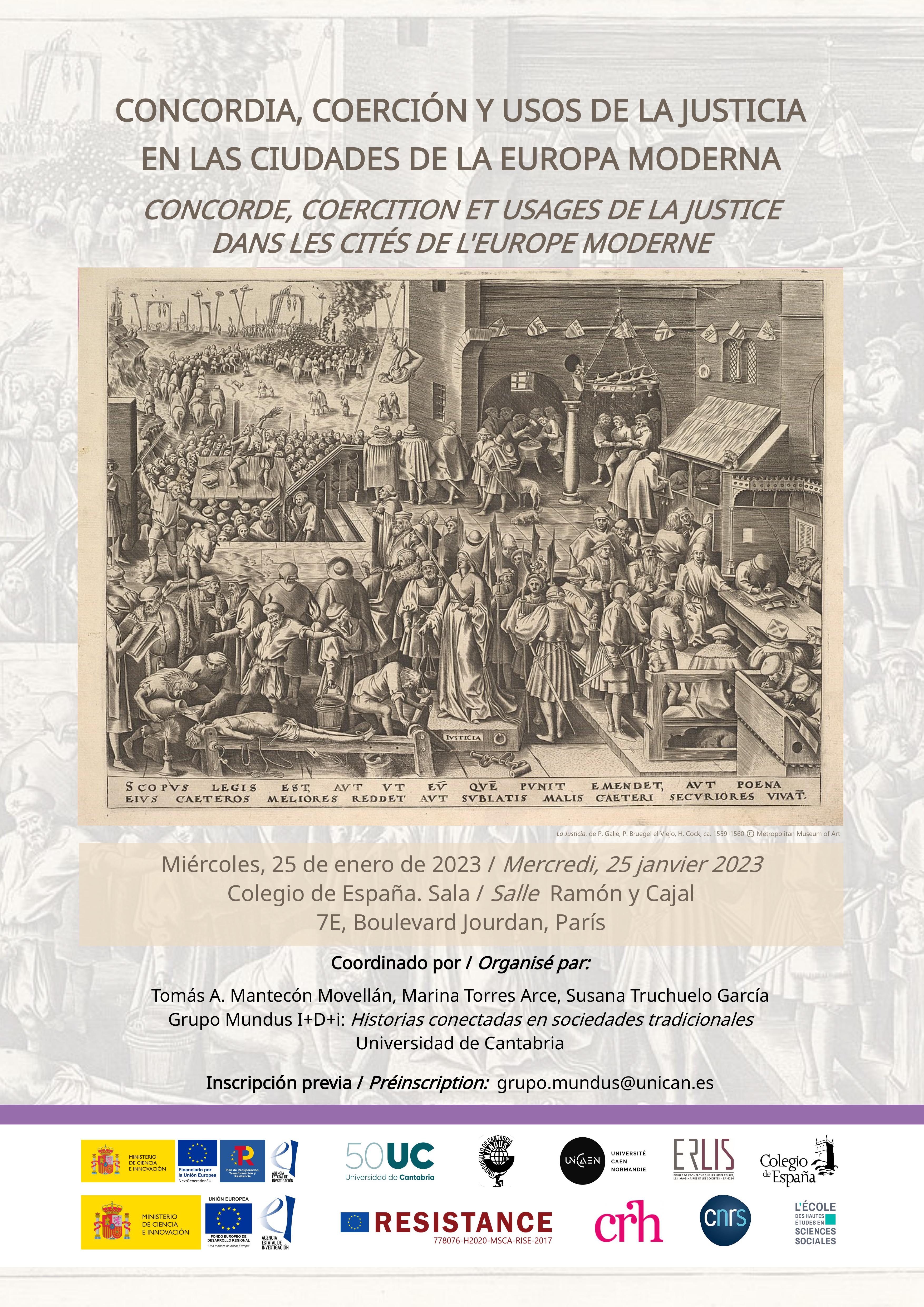




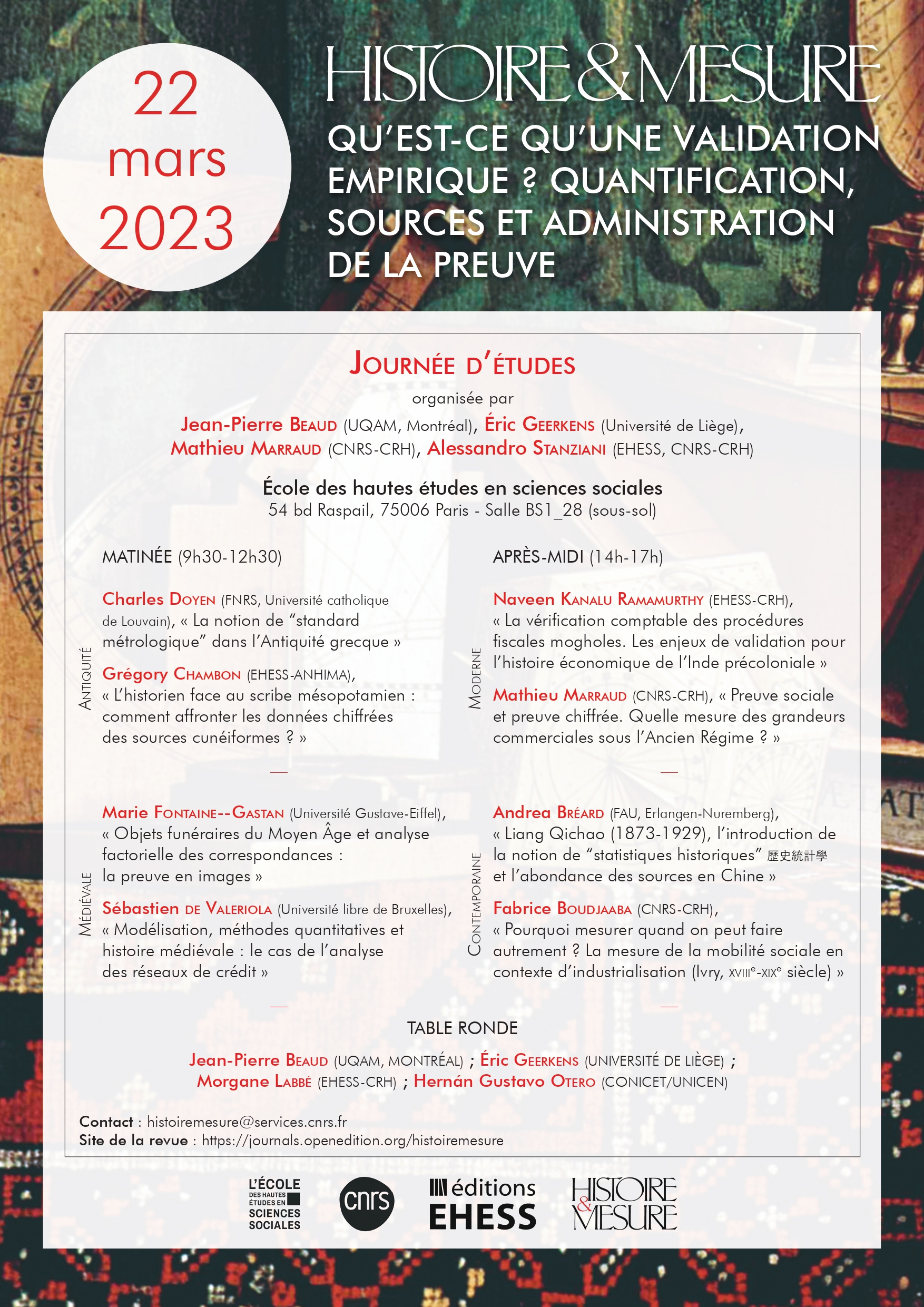



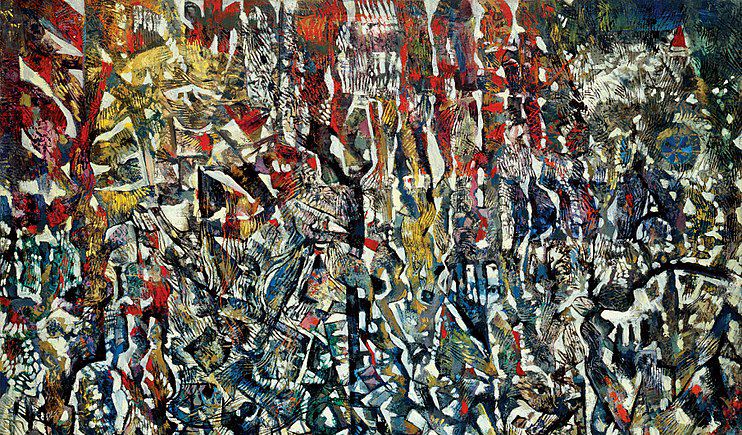
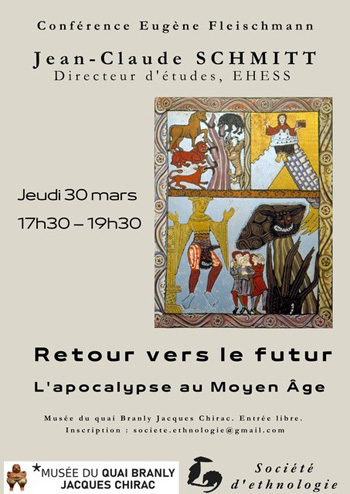
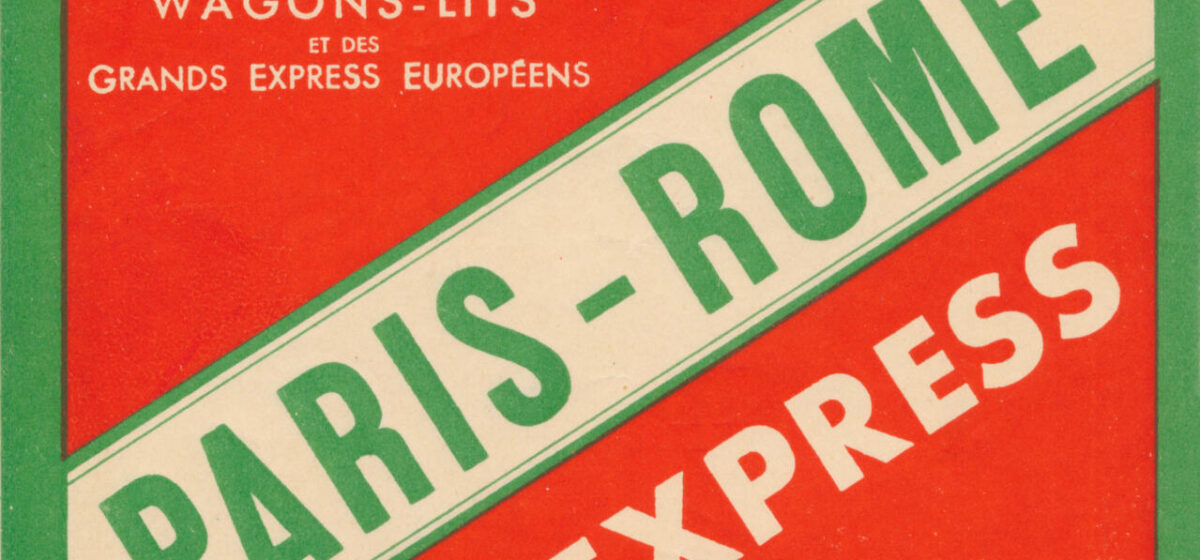

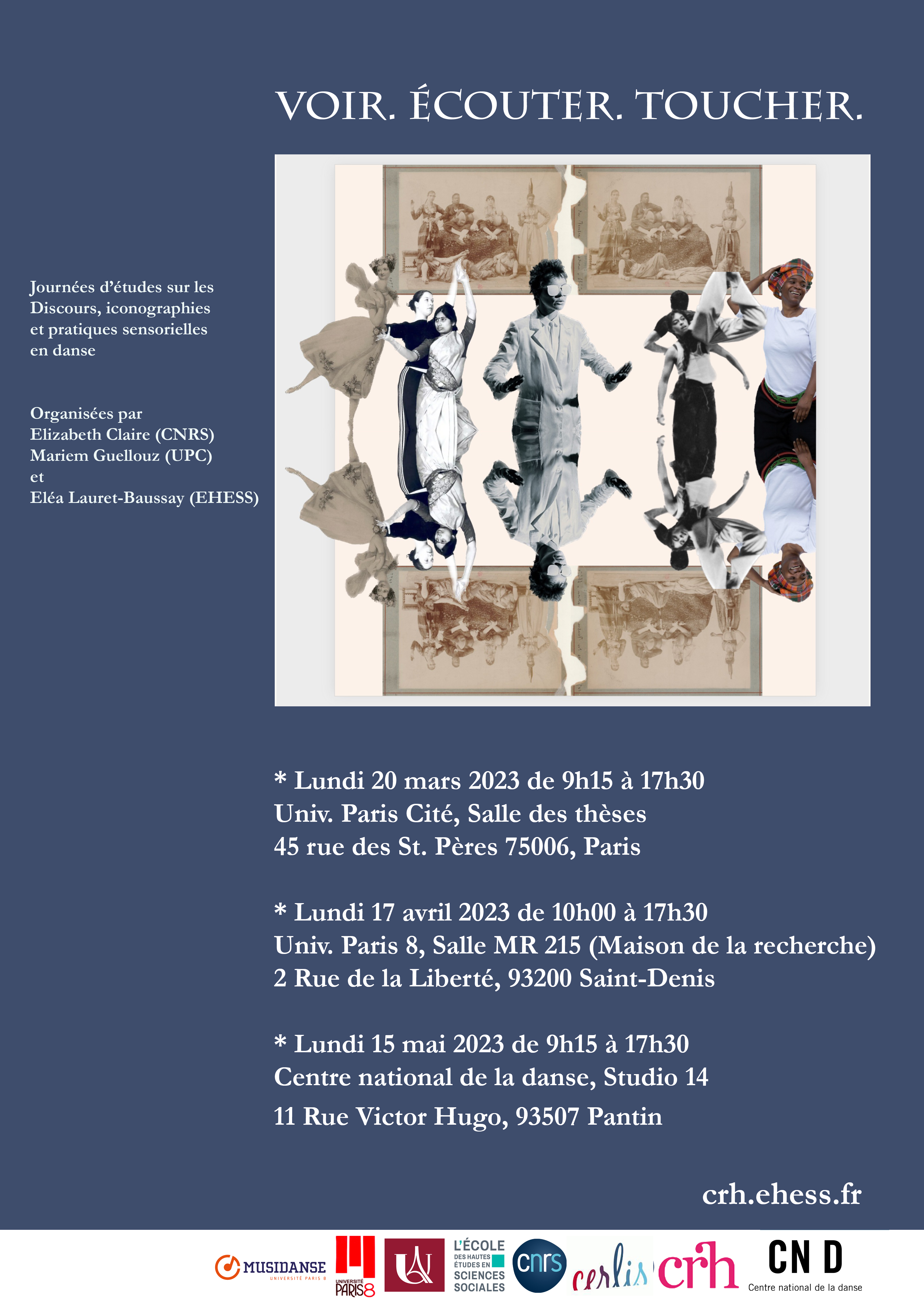
.jpg)
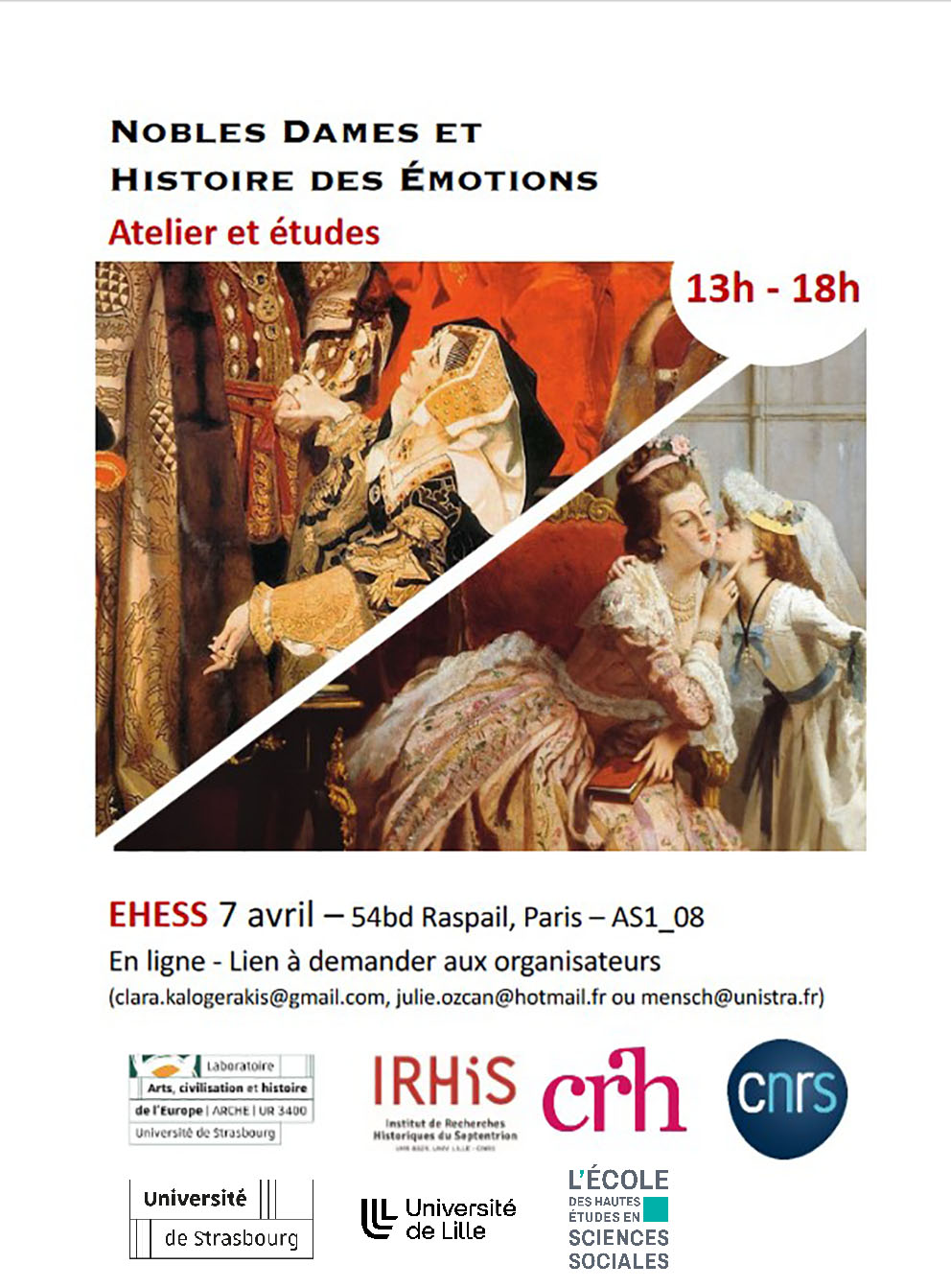

.jpg)


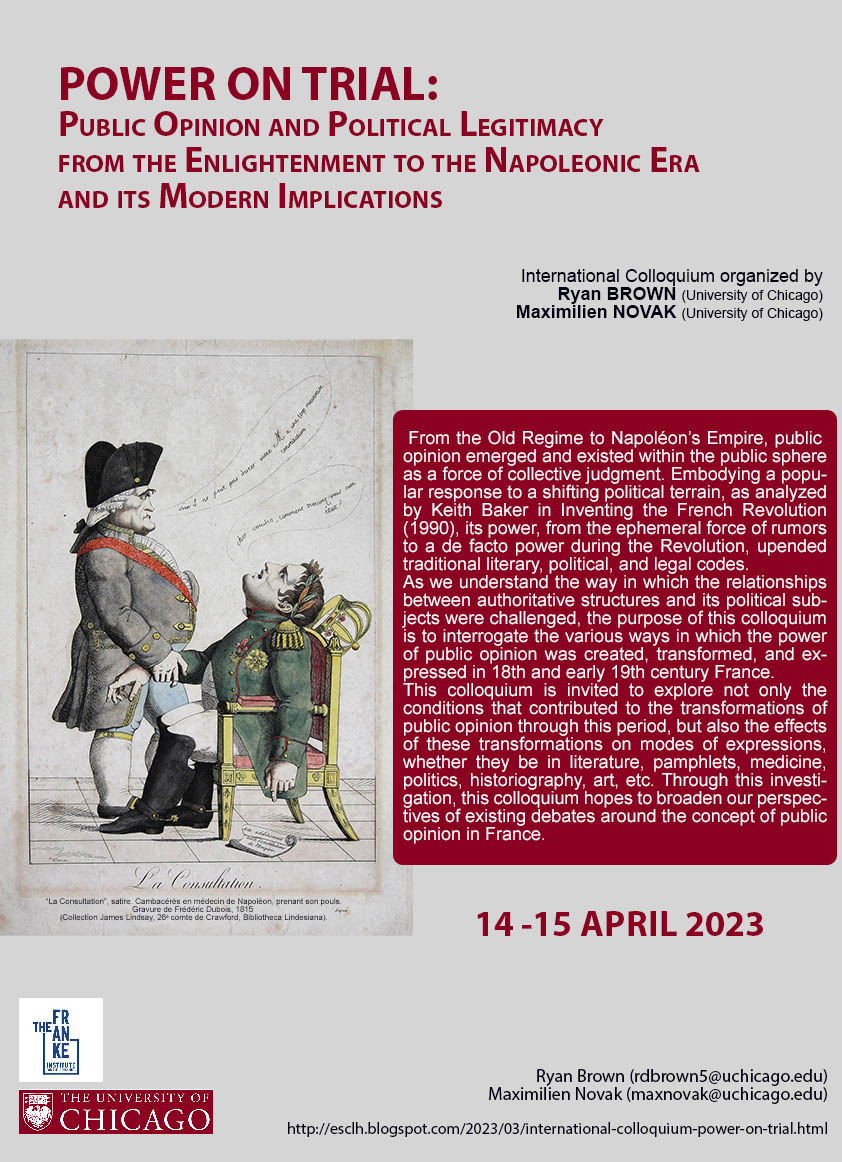
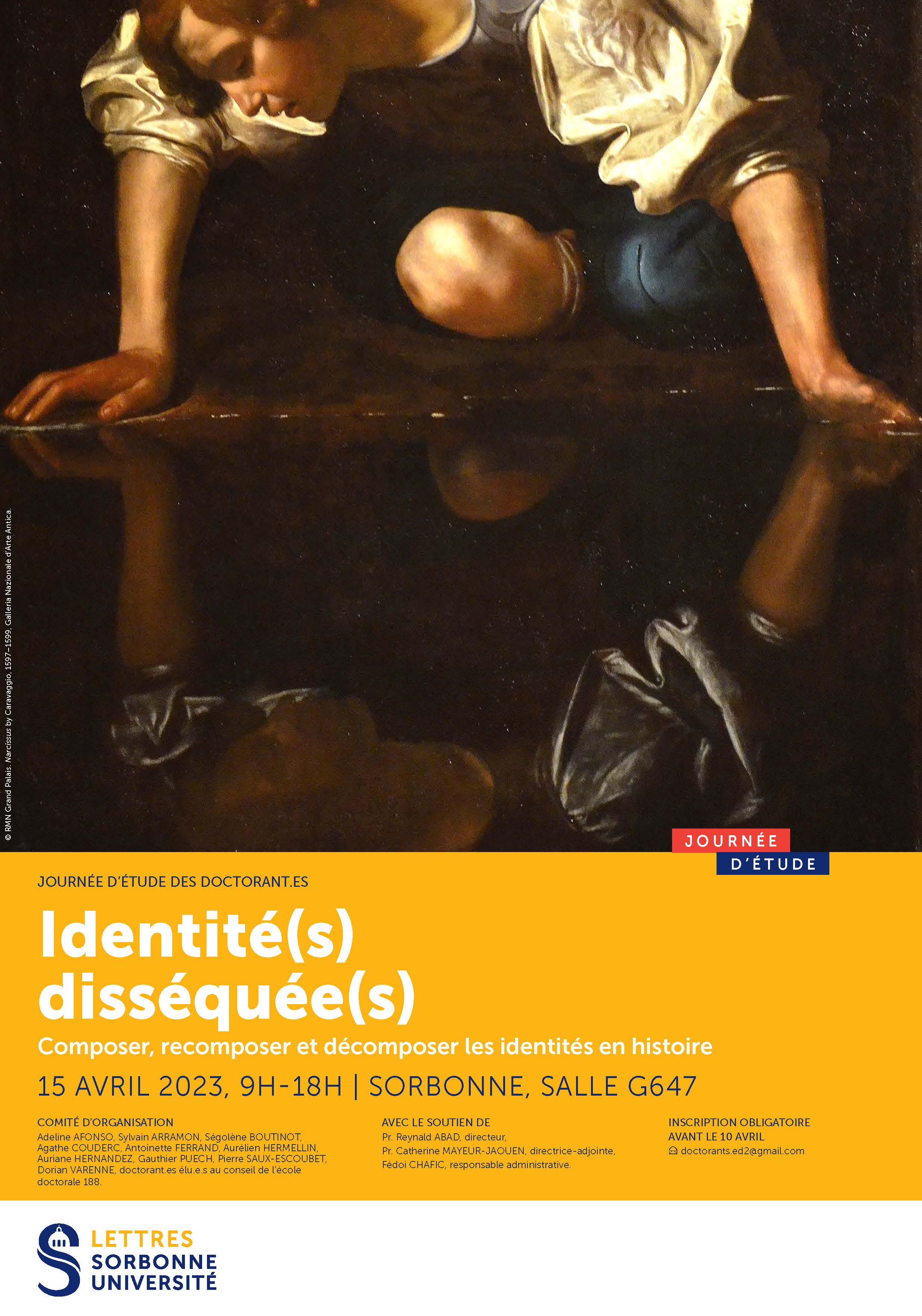
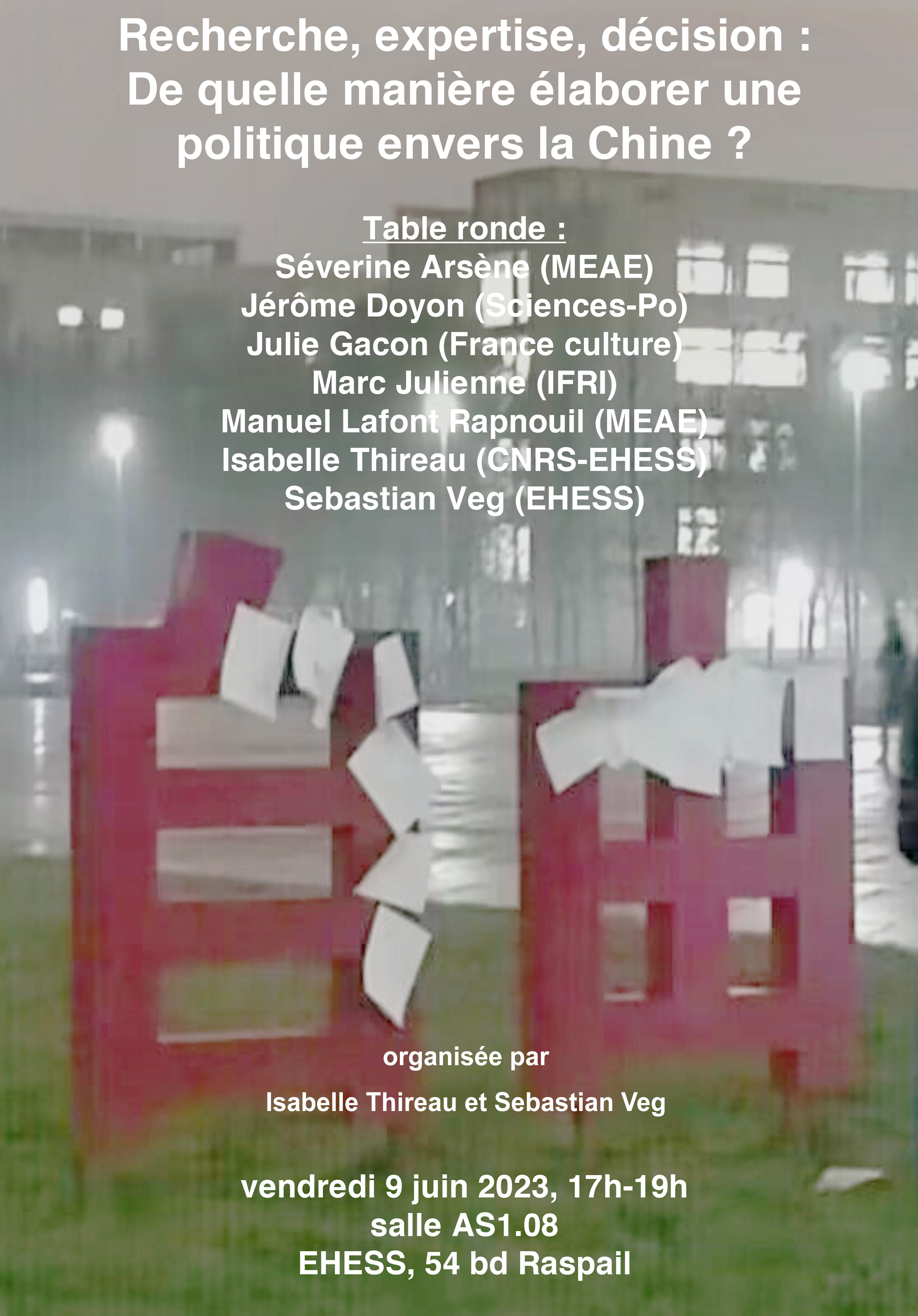

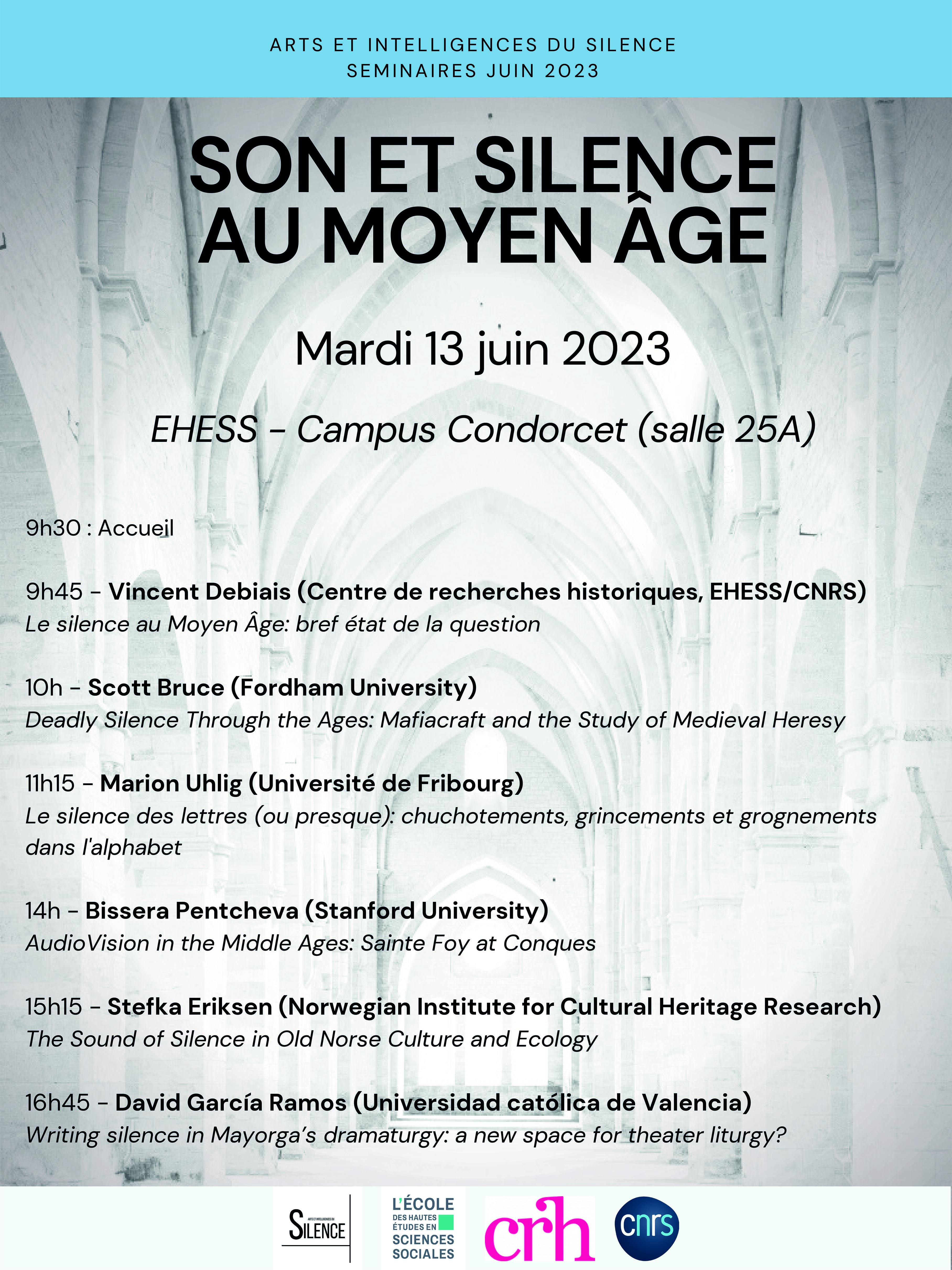

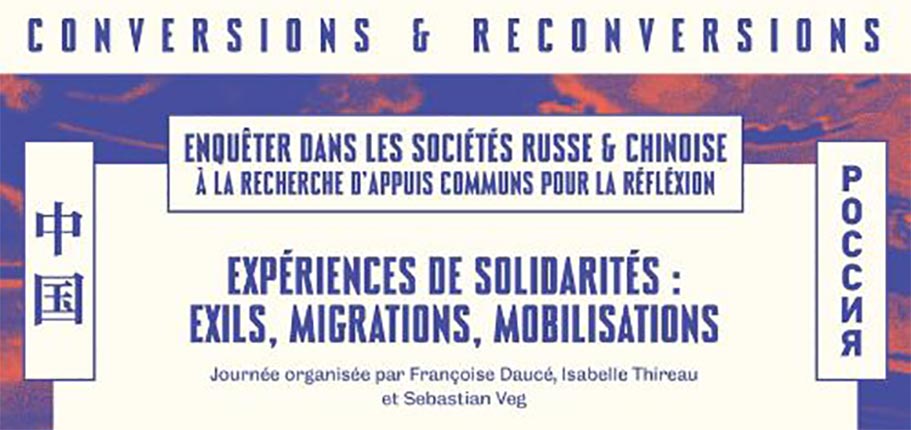
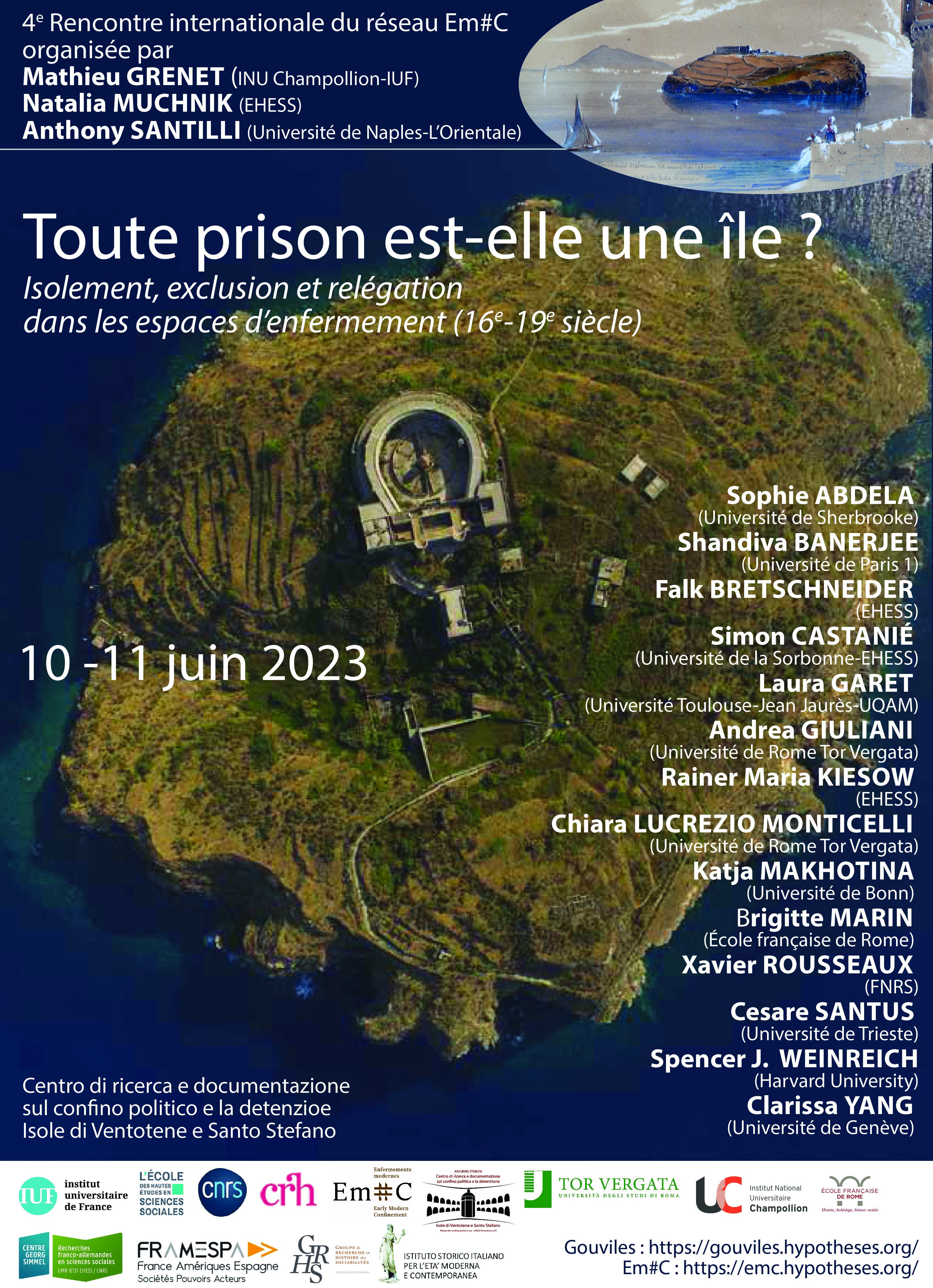
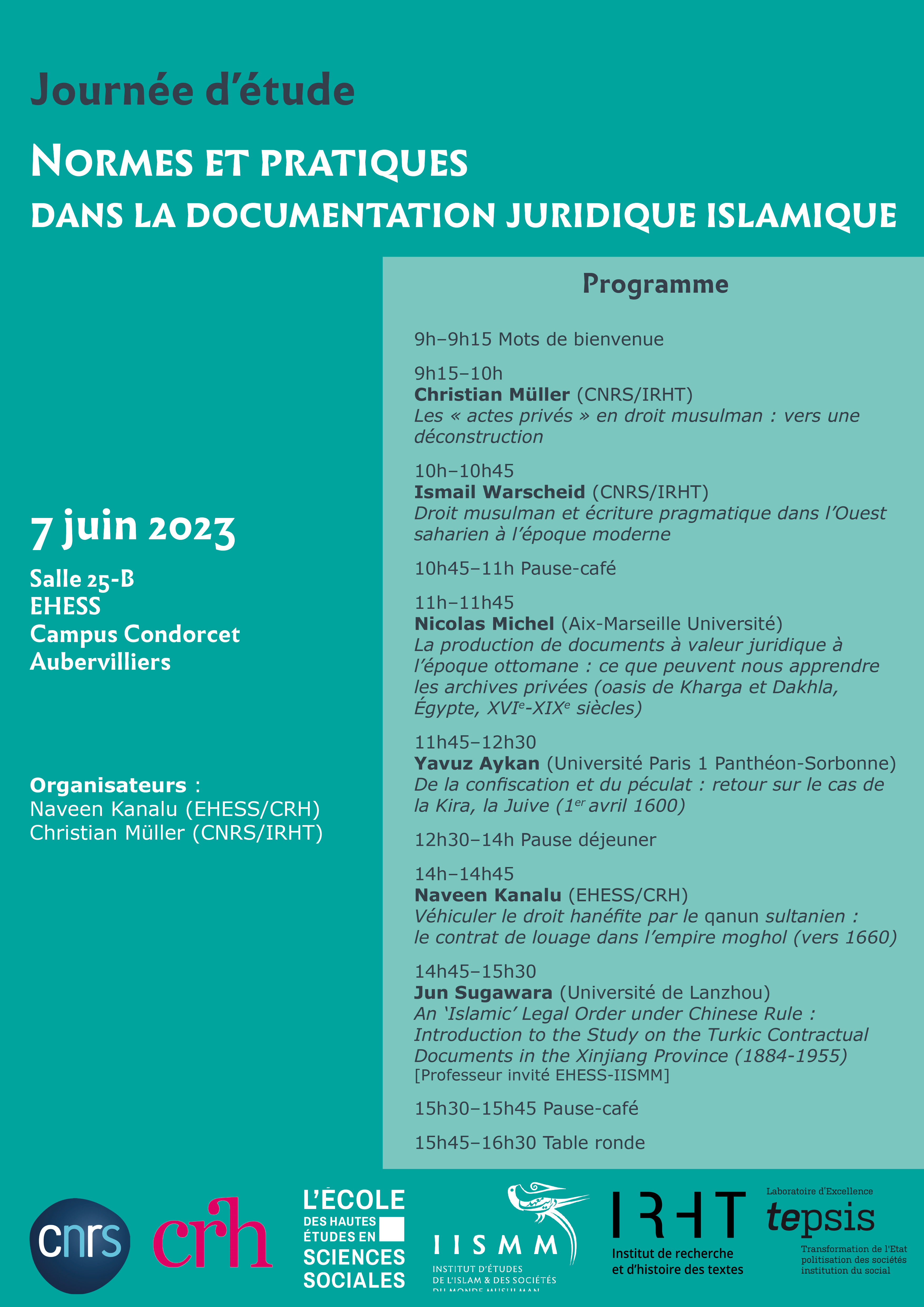
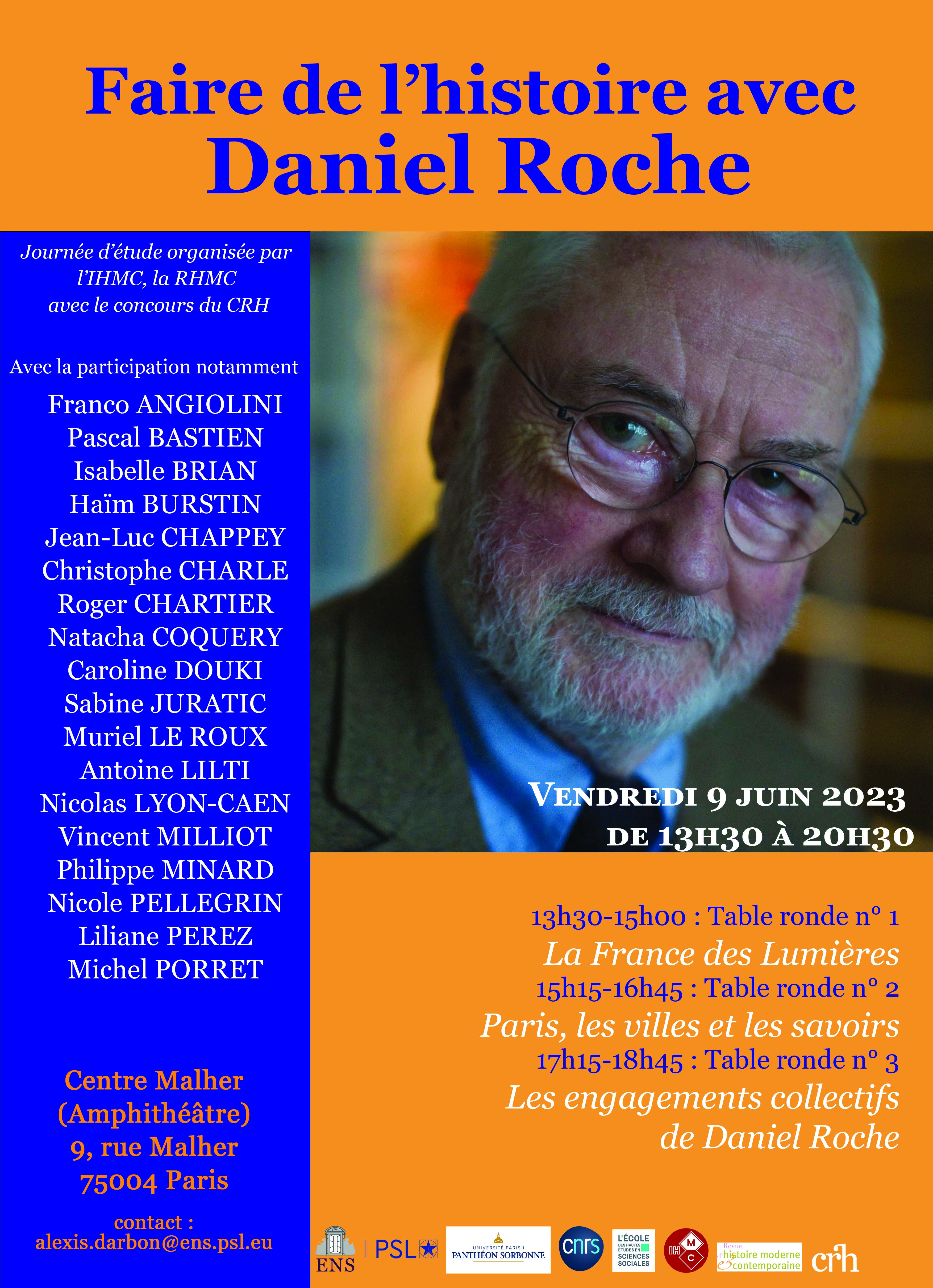

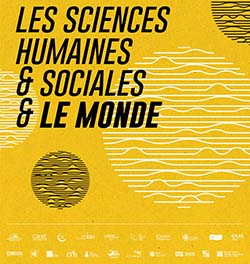


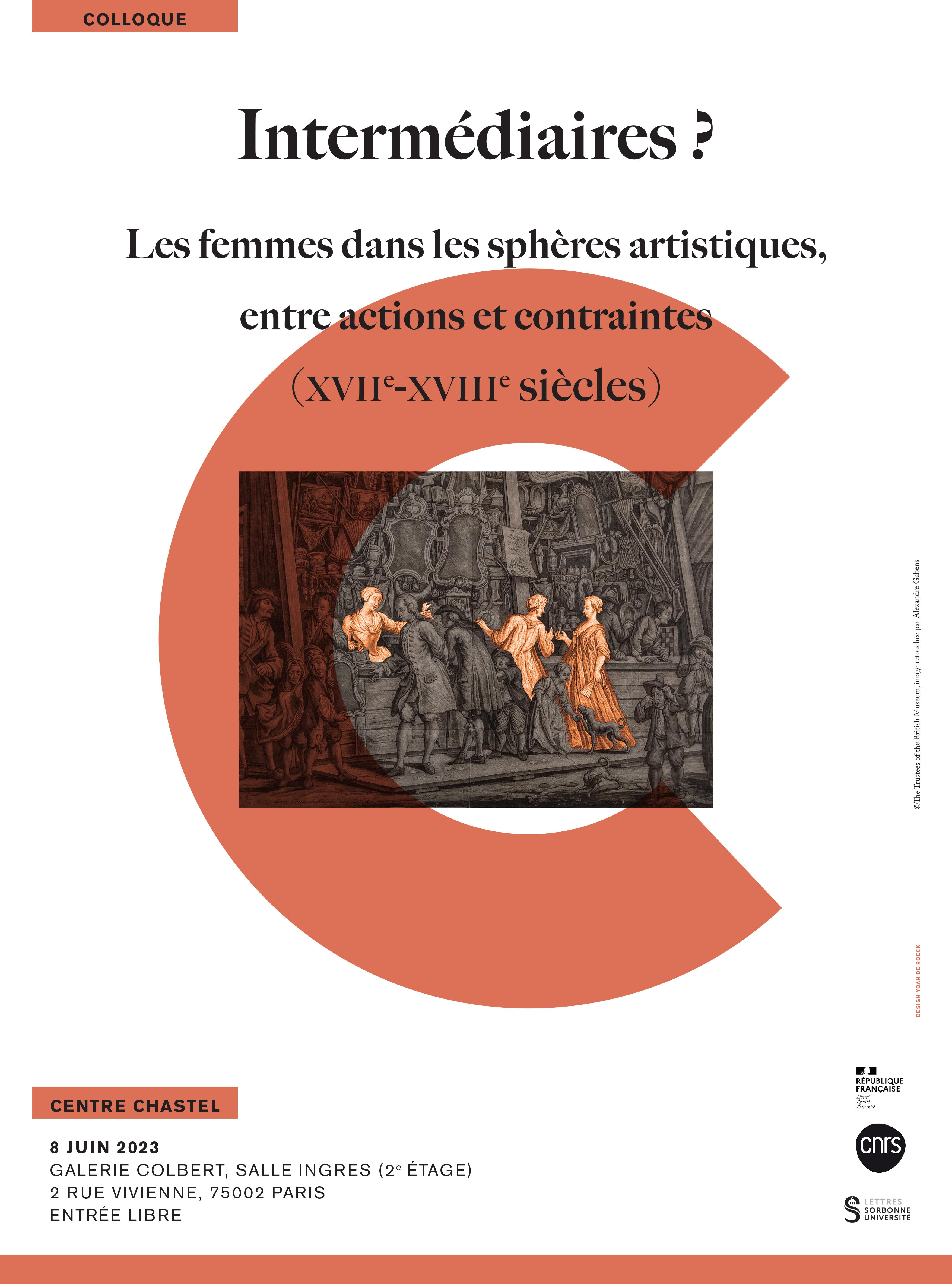


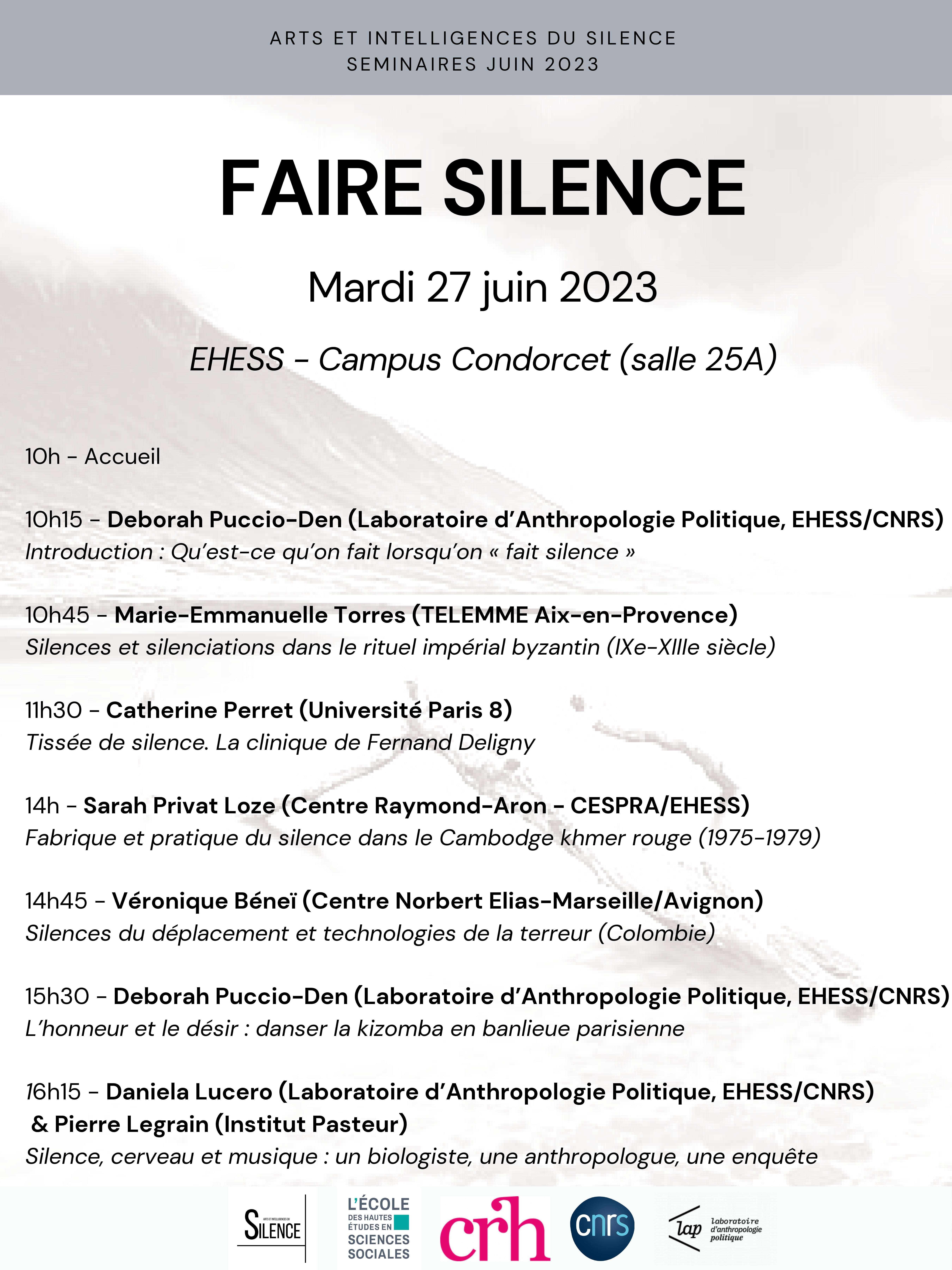
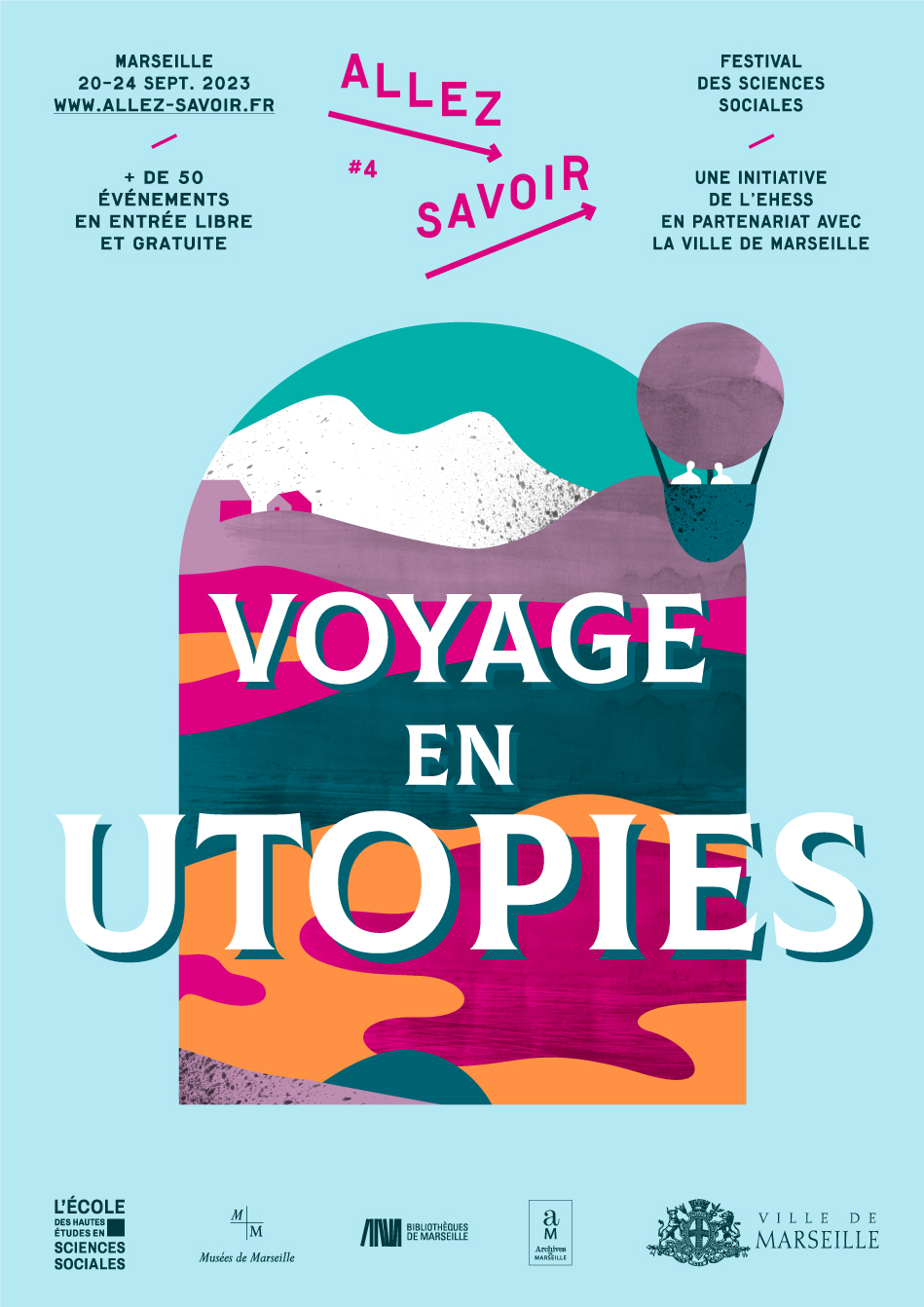
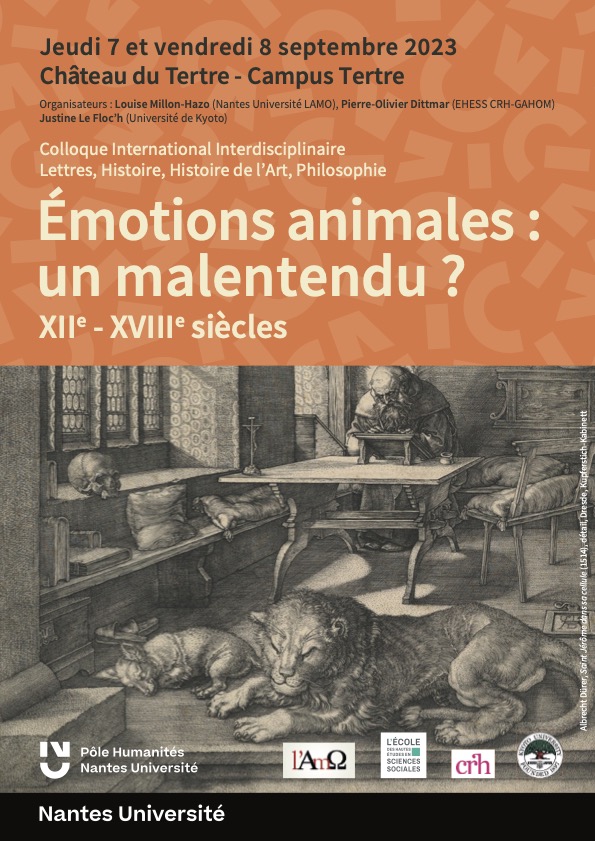

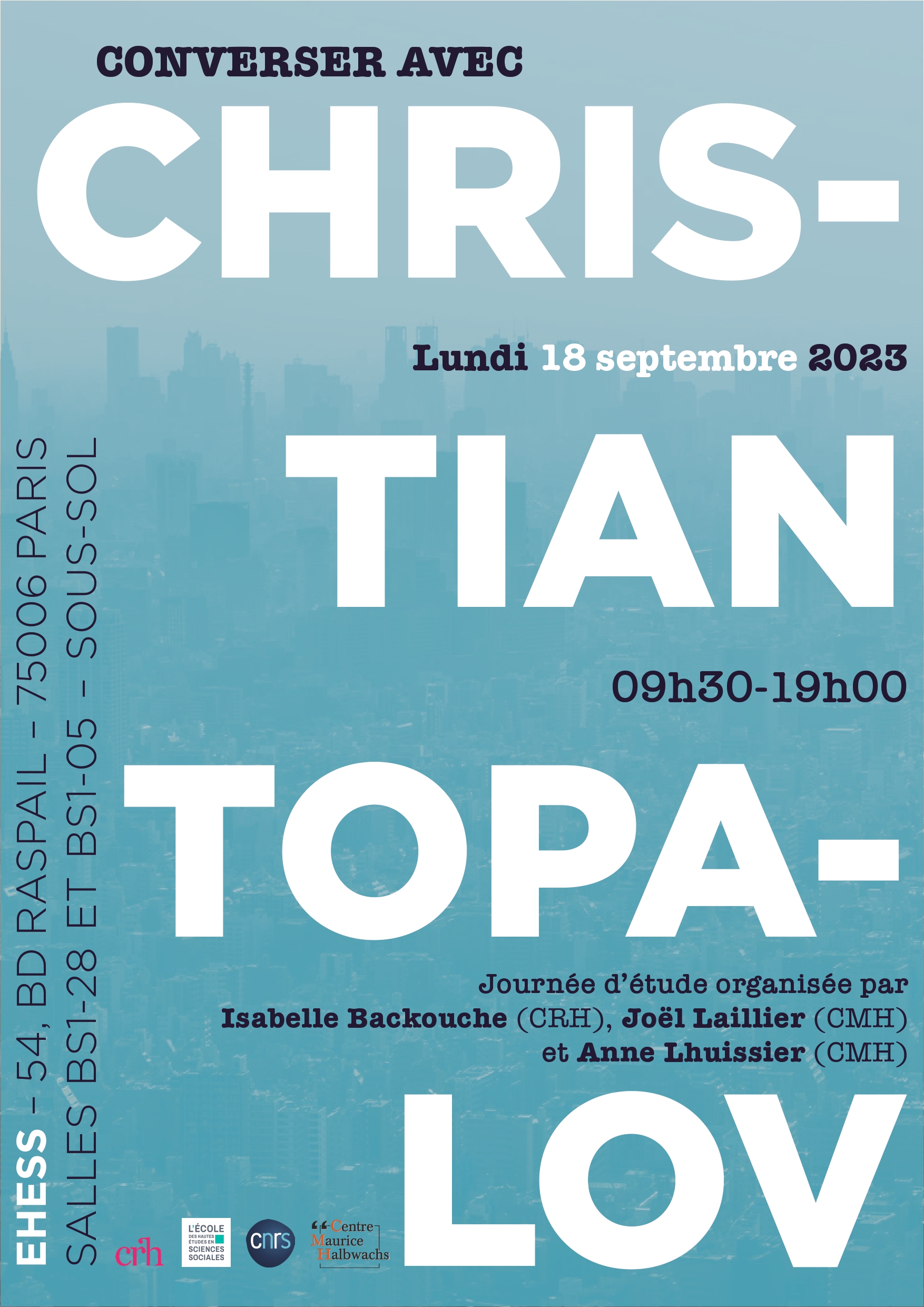

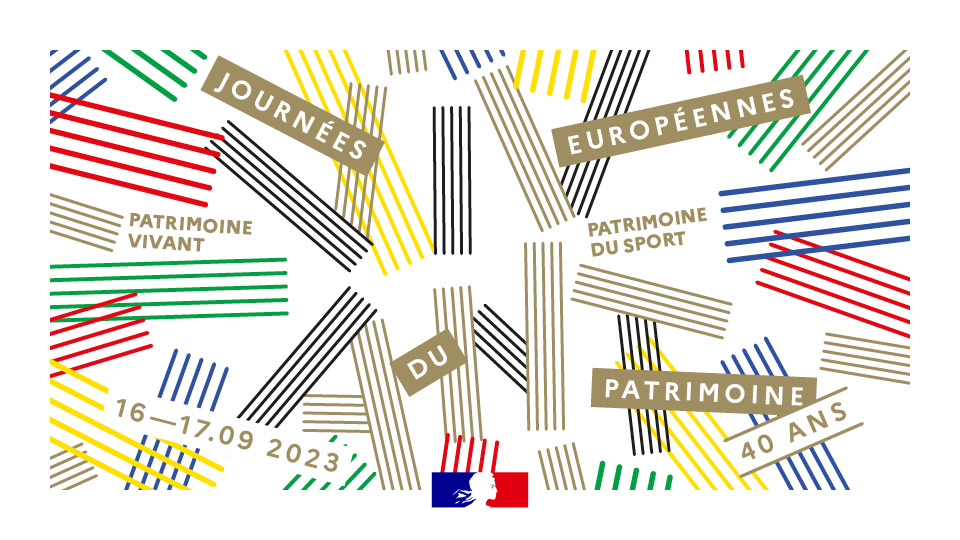

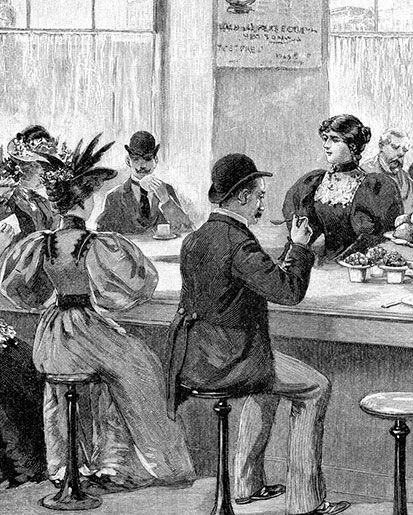

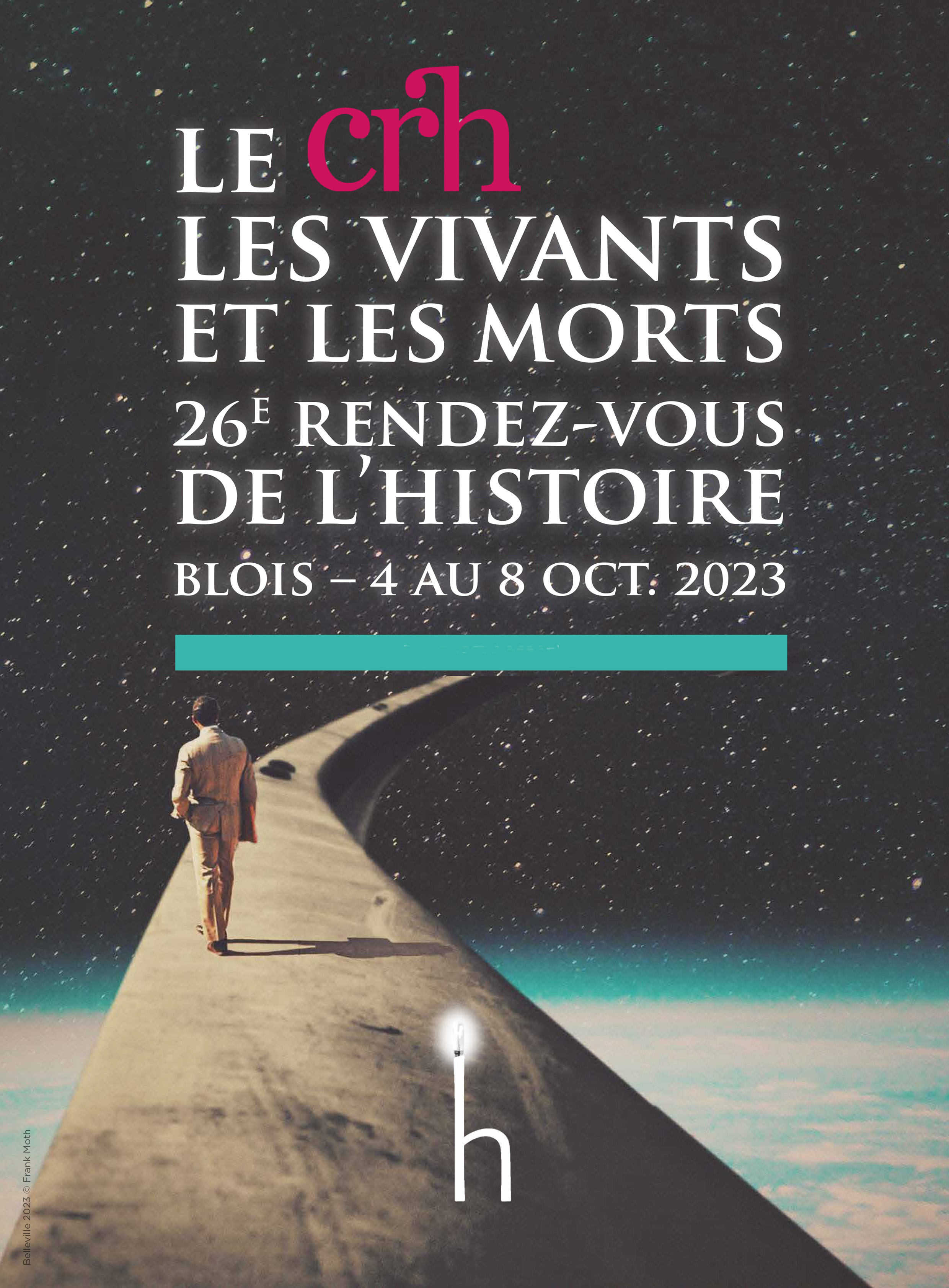
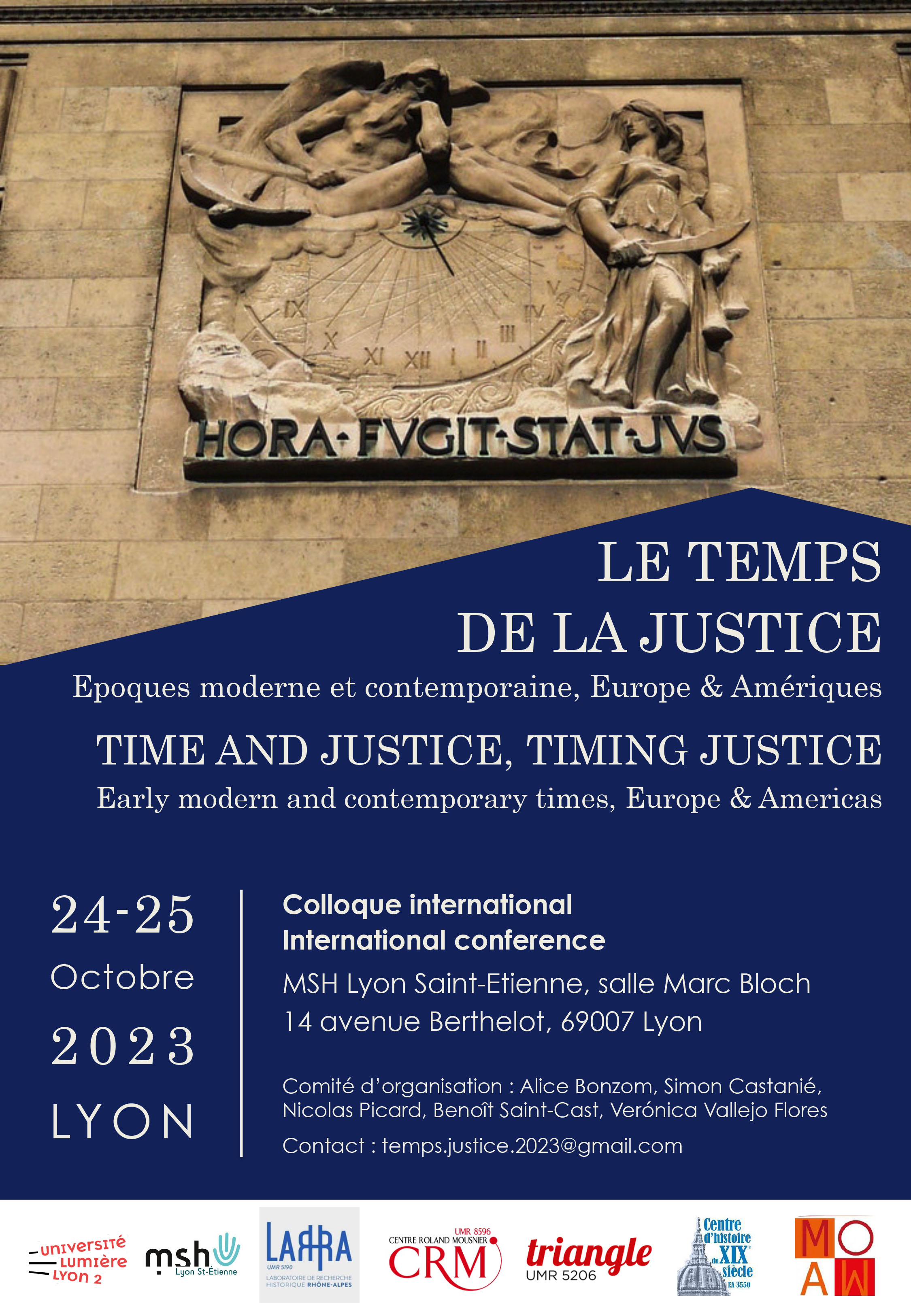
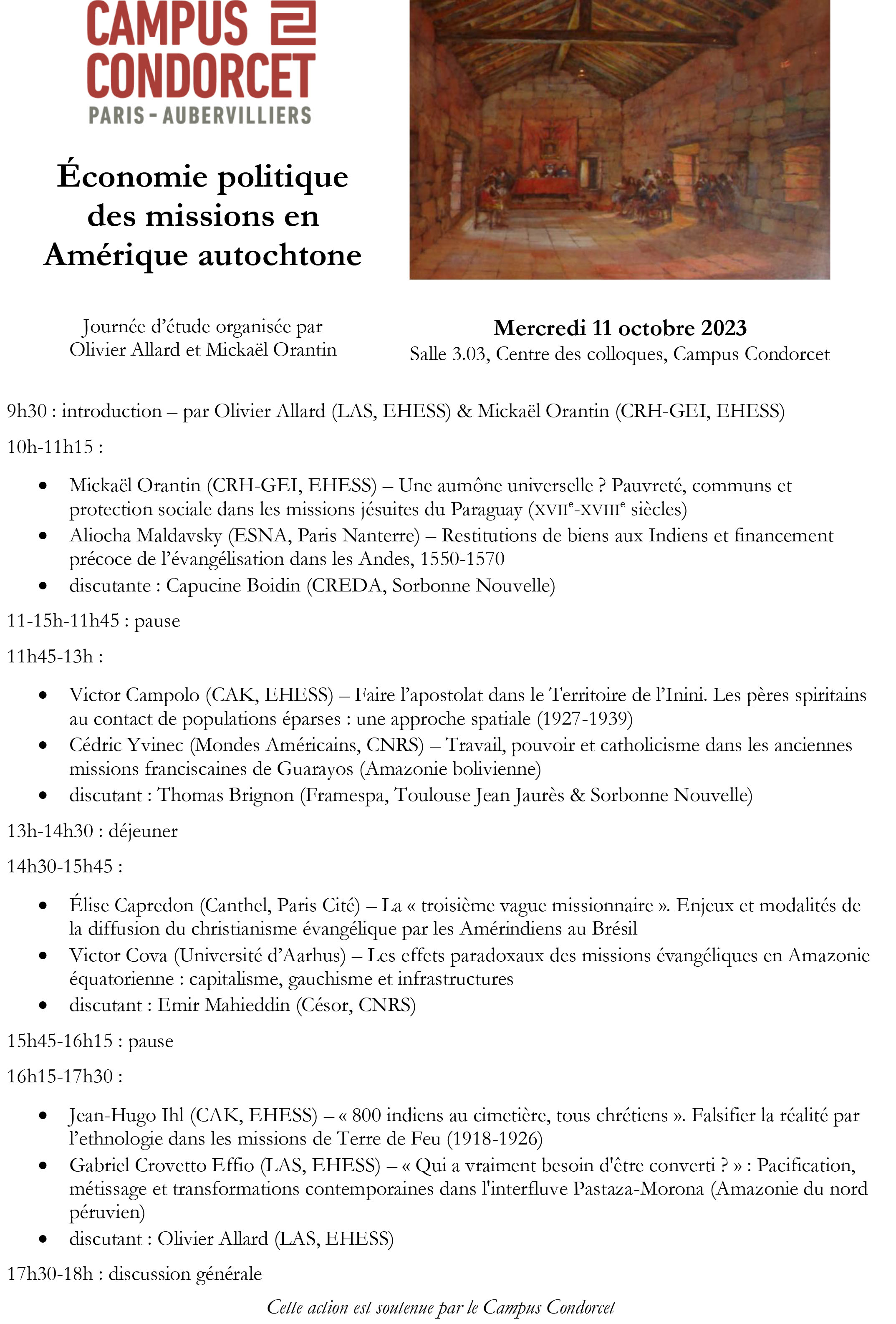


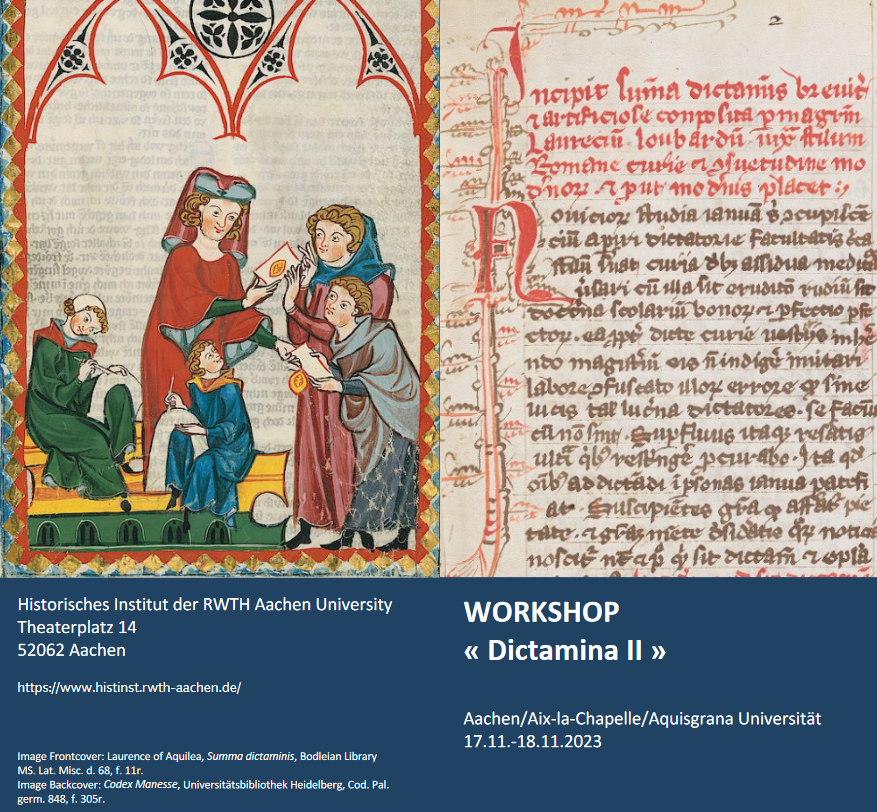


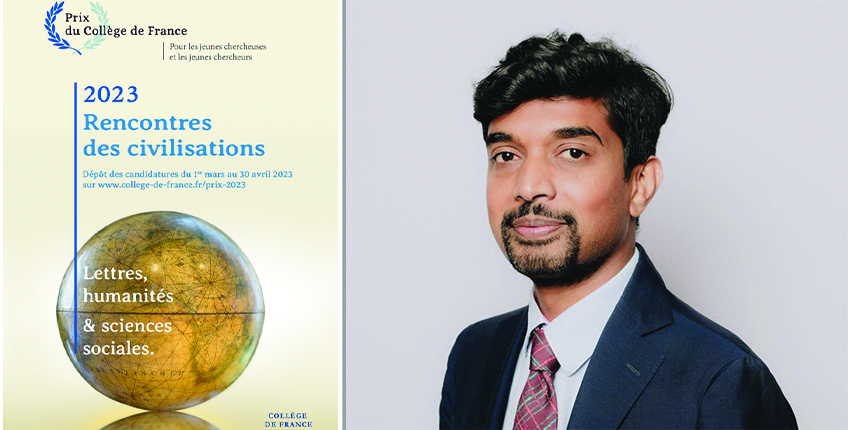
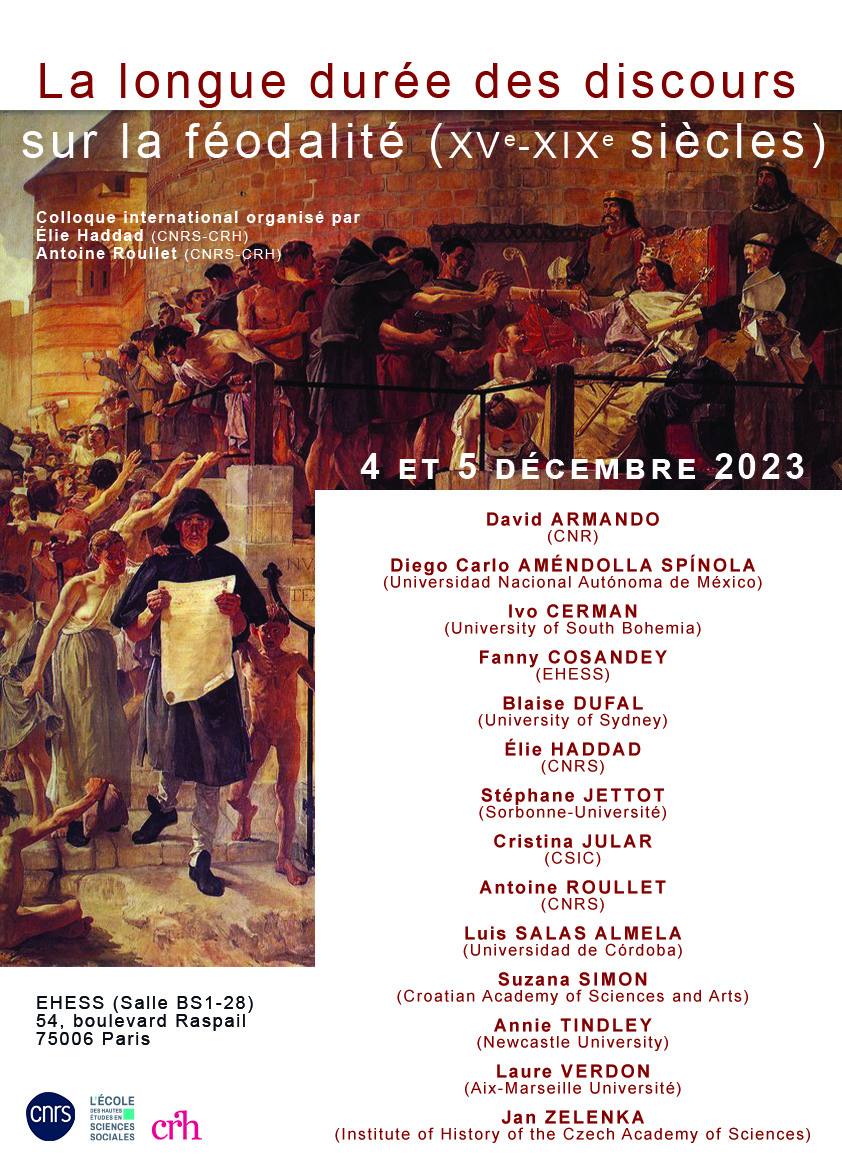


 Conférence -
Conférence -  Journée(s) d'étude -
Journée(s) d'étude -  Colloque -
Colloque -